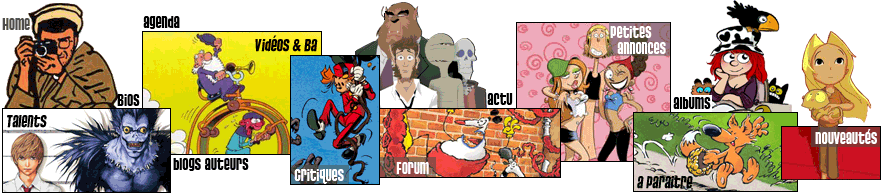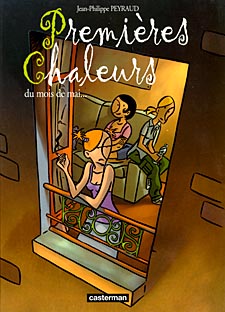
« Premières chaleurs, tome 1 : du mois de mai... » par Jean-Philippe Peyraud. Chez Casterman.
Difficile de ne pas rapprocher cet album du « Pyjama Party » de Christopher, paru quelques mois plus tôt à La Comédie Illustrée. D'abord, le thème est presque le même. Ensuite, le traitement est similaire. Enfin, il s'agit pour l'un comme pour l'autre d'un premier album en grand format et en couleur. Pour être complet, signalons que les deux auteurs se connaissent bien ; Christopher a publié Peyraud à La Comédie Illustrée. Bref, plutôt que de rechercher le plagiat, il faut davantage voir dans ces deux albums une communauté d'intérêts et peut-être même, le signe de l'émergence d'une école, qu'ont tirée derrière eux -parfois sans le savoir- des auteurs comme Dupuy et Berberian. Non seulement ces dessinateurs se caractérisent par un trait assez proche, mais en plus ils racontent des histoires profondément ancrées dans le quotidien qui, si elles ne sont pas directement autobiographiques, sont largement inspirées de la vie autour d'eux. Ainsi, quand Christopher prenait le parti de laisser parler des filles d'une vingtaine d'années de leurs amours, de leurs parents, de leurs rêves, etc... il les disposait sur quelques coussins dans une chambre et inventait la « pyjama party ». Peyraud, lui, fait à peu près la même chose, si ce n'est qu'il fait parler alternativement un groupe de garçons et un groupe de filles. Les uns sont continuellement en mouvement : on les voit au resto, dans la rue, chez un copain... les autres sont réunies dans un appart' et discutent entre elles tout en faisant participer une copine plus lointaine grâce au téléphone main libre. Pour passer des premiers aux secondes, Peyraud joue sur un procédé souvent utilisé en théâtre, qui consiste à faire terminer une phrase dite par un des protagonistes du premier groupe par l'un de ceux appartenant au second. C'est évidemment amusant, mais c'est vite lassant. Le recours systématique à ce petit truc devient gênant dès le milieu de l'album. En revanche, ce qui est drôle, c'est d'avoir choisi de montrer les deux facettes d'une même bande. Les mecs parlent entre eux de leurs nanas pendant que celles-ci parlent le plus souvent d'eux. Il y a quelques très belles trouvailles (la cocotte qui se promène pendant toute l'histoire, le coup de l'interphone bloqué,...) et surtout, il y a un ton qu'il n'est pas évident de garder tout au long d'un album de 46 pages. Les répliques sont souvent savoureuses, parfois cinglantes, les personnages en font juste assez pour qu'on y croie. Bref, ça tient la route. En revanche, j'avoue préférer le dessin de Jean-Philippe Peyraud sans les couleurs. J'invite ceux qui auraient un doute à lire ou relire le très beau « Il pleut », paru à La Comédie Illustrée.