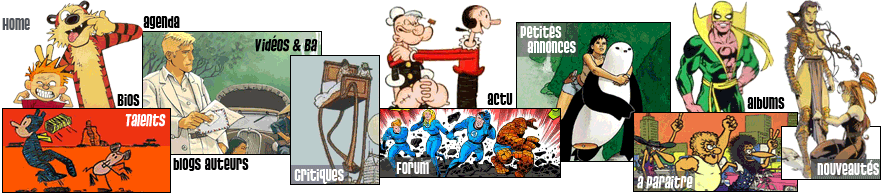Flag par Thierry Bellefroid 

« Flag » et « Trois allumettes » dans la collection « Encrages » de Delcourt.
Manifestement, David Chauvel se sent bien chez Delcourt. Depuis le premier tome de « Rails », en 92, il y a publié plus de quinze albums ! Tous font partie de séries, dont trois sont à présent terminées (Rails, quatre albums couleur et une intégrale noir et blanc. Les Enragés, cinq albums dans la collection Sang Froid. Nuit Noire, trois albums et une intégrale couleur.) Tous, sauf ces deux nouveaux albums en noir et blanc, parus dans la collection Encrages. Une envie de changement...ou une sorte d'aboutissement ?
Je serais tenté de dire que ces deux albums sont une suite logique aux derniers travaux de Chauvel. Spécialiste des « road-movies » à l'américaine, il nous a toujours baladé dans des courses poursuites haletantes tout en tentant de brosser au passage des portraits de héros ni vraiment noirs ni tout à fait blancs. « Les Enragés » constituent à ce jour sa plus belle réussite, les cinq albums racontant une folle cavale de sept jours à travers les Etats-Unis. Et puis, il y a eu « Le Poisson-clown », en 97, qui reprenait le même type d'ingrédients mais sur un mode narratif plus élaboré et enfin le très réussi « Ring Circus » avec Cyril Pedrosa, l'an dernier. Chauvel ne cachait plus ses velléités d'écriture. Il montrait son intérêt pour la psychologie des personnages, plus que pour la mécanique du récit. On ne peut que s'en réjouir, même si l'on doute qu'il arrive un jour à égaler Luc Brunschwig, également scénariste chez Delcourt, et maître absolu du genre avec deux de ses séries : « Le Pouvoir des Innocents » et « L'esprit de Warren » (collection Sang Froid, à lire absolument, si vous ne connaissez pas encore) Dans la droite ligne de ses nouvelles aspirations, David Chauvel propose donc deux albums entièrement consacrés à la psychologie de ses personnages : « Flag » et « Trois allumettes ». Deux ouvrages complémentaires, les deux facettes d'une même volonté scénaristique.
Dans « Flag », Chauvel retrouve Le Saëc (Les Enragés) qui n'aime rien mieux que le dessin brut, rapide, peu encombré de décors. Le noir et blanc lui va à ravir, mais sa paresse naturelle pousse parfois le dessinateur breton au minimalisme (un petit effort sur les voitures, entre autres, ne serait pas négligeable...) La narration est le vrai héros de l'histoire. Le lecteur est balancé entre les derniers moments qui précèdent une fusillade (« Jeudi, deux heures avant la fusillade », « Jeudi, quinze minutes avant la fusillade », etc...) et les vingt deux mois qui précèdent. L'occasion de mettre en place les acteurs qui vont se retrouver face à face au moment fatal et de leur inventer une relation. L'envie n'est plus de montrer comment des enchaînements d'éléments peuvent déteindre sur les héros, mais de raconter comment des héros peuvent être amenés à poser certains actes en raison de leur passé et de leur profil psychologique. C'est réussi, même si ça reste encore un peu superficiel et académique.
Autre dessinateur pour « Trois allumettes ». Hervé Boivin a vingt-cinq ans et signe ici son premier opus. Un dessin très influencé par le Rabaté d'avant Ibicus, par Blutch aussi, et par moments, proche de ce que fait Edmond Baudoin. Bref, un noir et blanc tranchant, anguleux, qui doit encore trouver sa propre personnalité, mais déjà efficace. Ici encore, Chauvel se plaît à bousculer les principes habituels de la narration. Deux femmes, l'une jeune, l'autre moins, vont tout abandonner et devenir braqueuses à la petite semaine. Pourquoi ? L'une et l'autre racontent, se racontent, brouillent les pistes, lèvent un coin du voile. Et pendant ce temps, un troisième personnage, flic étrange apparemment névrosé, remonte la piste tout en laissant apparaître ses propres fragilités. Il n'est pas facile d'entrer dans cet album. Notamment, parce qu'il se compose de fragments épars, sorte de kaléïdoscope narratif qui ne se laisse apprécier qu'avec une vue d'ensemble. Mais « Trois allumettes » est certainement le plus abouti des scénarios de David Chauvel. Et sans conteste le plus réussi dans sa recherche d'histoires plus intimistes, de héros plus fouillés. Il y a quelque chose de « Thelma et Louise » dans « Trois allumettes ». Mais curieusement, le scénariste spécialiste du « road-movie » se distingue du film en offrant plutôt une histoire immobile, en miroir, à la recherche des identités de ses protagonistes. C'est tout à fait réussi. Et on espère que pour Chauvel, ce n'est qu'un début.