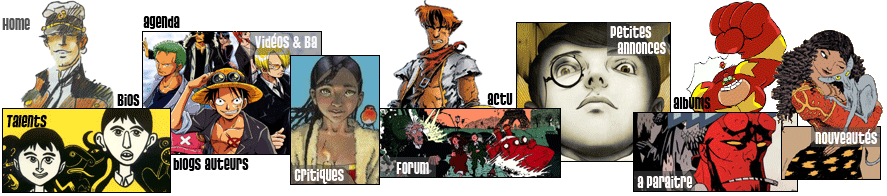"La caste des Méta-Barons, Tome Sixième : Doña Vicenta Gabriela De Rokha, lAïeule", par Jodorowsky et Gimenez, aux Humanoïdes Associés.
Tonto et Lothar, les deux robots, continuent de remonter larbre généalogique du Méta-Baron leur maître. Partis dOthon, le Trisaïeul, ils se rapprochent peu à peu du présent. Quoique. A ce rythme-là, Jodo risque bien de nous balader encore pendant six ou sept albums avant de nous dire pourquoi lactuel Méta-Baron a une cicatrice au milieu du sourcil droit. Cest pas que lhistoire soit lente. Au contraire, hormis les habituelles digressions que lon doit aux deux robots (devenus héros à part entière puisque les voilà menacés de destruction par leur propre maître), le rythme est toujours aussi trépidant. Mais que davatars, de rebondissements, de retournements de situation...
Les Méta-barons, on aime ou on déteste. Pas de demi mesure. Dabord, le dessin de Gimenez laisse rarement indifférent. Là encore, il y a ceux qui aiment... et les autres.
Dans le genre dessin SF héritier de la période aérographe, je le trouve plutôt réussi.
Jaime moins ces découpages diagonaux parfois démesurément présentés en double page, mais tout cela est finalement bien subjectif. Pour le reste, il faut aimer le style de narration de Jodo et surtout, sa mystique, ses manies, ses thèmes de prédilection : linitiation, ladoration, le fanatisme, lhonneur, la violence, la mutilation, limpossible quête du bonheur et de lamour.
Ce « Tome Sixième » est relativement conforme à ce que lon pouvait en attendre, après la conclusion dun premier cycle qui a débouché sur une publication en coffret des cinq premiers livres. On reprend les mêmes et on poursuit. Plus que jamais, les mutilations sont au coeur du récit et la tragédie son moteur. Jodo a dû lire lensemble des volumes de la tragédie grecque. A commencer par Oedipe qui inspire le mythe fondateur de cette Caste des Méta-Barons. Cécité, mort du père, inceste, des thèmes vieux comme le monde que cet orfèvre nous ressert sous un jour science-fictionnesque, si vous me permettez lusage de ce néologisme.
Doña Vicenta Gabriela De Rokha est sans doute la plus aboutie des « Aïeules » présentées jusquici, celle qui pousse le don de soi jusquà la cécité, celle qui met lamour au-dessus de tout et qui se fera « manger » (le mot est à peine exagéré) par la pire de toutes, Oda-Honorata lincestueuse. Rien à dire, la tragédie fonctionne ici en plein. Le personnage schizophrène de « Tête dAcier », pris entre ses deux identités contradictoires, ajoute encore au puzzle psychanalytique que compose patiemment Jodorowsky. Je le diasis : on aime ou on déteste. Mais si on aime, ce « Tome Sixième » est sans doute lun des meilleurs !