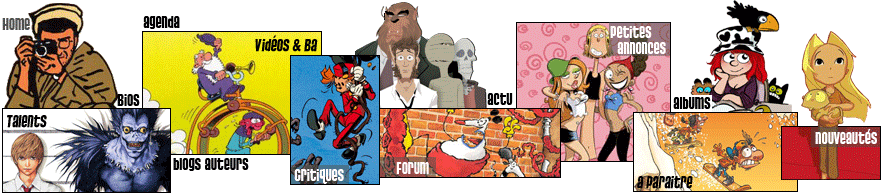« La fille qui rêvait d'horizon », une enquête de l'inspecteur Canardo, par Benoît Sokal, chez Casterman
Canardo était absent des librairies depuis 1994. Et on avait presque fini par oublier combien il nous manquait. En cause, bien sûr, le CD-ROM de l'Amerzone, dans lequel Benoît Sokal avait jeté toutes ses forces et qu'il présentait en janvier dernier au festival d'Angoulême. Ce travail considérable, très différent de la BD, pouvait faire craindre une disparition définitive de l'inspecteur palmipède alcoolo. Fort heureusement, revoilà Canardo. Et au mieux de sa forme. La comparaison entre cet album et les deux derniers -voire les trois derniers- est à cet égard sans appel.
Première constatation, Sokal n'est pas sorti indemne de sa longue cohabitation avec l'informatique. Les couleurs -et principalement les ciels- de la première planche suffisent à la prouver. Et puisqu'on parle de couleurs, c'est sans doute ce qui frappera le plus le lecteur après deux albums qui faisaient appel à de larges aplats de teintes très basiques -rouge, bleu et surtout vert-, voici un album tout en nuances, en demi-teinte, en clair-obscur. L'ombre est partout, la lumière presque toujours indirecte, la plus grande part de l'histoire se passe la nuit. Un crépuscule et une aube très soignés. Ca sent la maîtrise et l'envie d'en découdre. Sokal s'est manifestement mis en difficulté sur cet album comme il ne l'avait plus fait depuis longtemps.
L'autre remarque qui me vient à la lecture de cette « fille qui rêvait d'horizon », c'est l'incroyable habileté de l'auteur à délayer en 46 planches une action qui se déroule sur quelques heures à peine en temps réel. Et qui se passe pratiquement en huis-clos ! S'il devait y avoir un Audiard de la BD, Sokal pourrait sans doute prétendre au titre. Ses textes sont toujours efficaces, tranchants, désabusés, comme le sont les personnages eux-mêmes. Quand la tenancière de l'auberge assène à Canardo un « z'êtes pas bavard » et qu'il lui répond « j'suis laconique... pas pareil », on est en plein dans le mille. De même quand le canard, revolver brandi, envoie cette phrase : « ce qu'il y a de pratique, quand on explose un motard, c'est que la cervelle reste dans le casque : c'est moins salissant ». Vous l'avez compris, moi, j'en redemande, surtout qu'il faut ajouter à cela, comme toujours, l'expression des personnages et principalement celle de Canardo, dont le regard vide vient en contrepoint des dialogues, avec cette touche de second degré qui caractérise la série.
Venons-en aux points moins positifs, peut-être. Les personnages sont assez stéréotypés -surtout Pamela Johnson, évidemment ; le nom suffit à lui seul à planter le décor... et le châssis ! La tension monte pendant la deuxième partie de l'album pour déboucher sur une fin dépourvue d'imagination, c'est dommage. C'est même franchement décevant, car sans cela, on aurait eu entre les mains l'un des meilleurs albums de la série. (Bien sûr, il n'y a pas de comparaison avec le mythique « Amerzone », mais quand même...) Le personnage de Raspoutine est usé jusqu'à la moelle. La seule manière de le « vendre » encore est d'en faire autre chose. Or, c'est juste l'inverse que nous propose Sokal.
Ces critiques ne doivent pas masquer le plaisir réel que j'ai pris à lire cet album. Le plaisir d'un fan trop longtemps privé de l'une de ses séries préférées et qui retrouve un univers à la hauteur de ses souvenirs. Et un découpage dans lequel Sokal excelle, y compris -et peut-être même surtout- quand ses personnages se taisent !