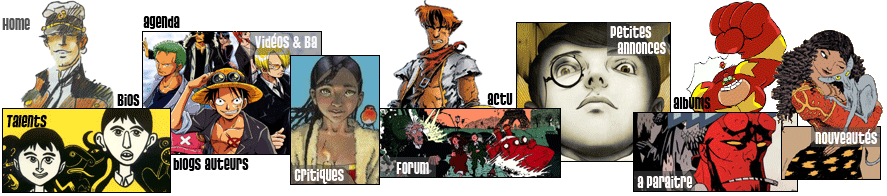« Les cosmonautes du futur », par Manu Larcenet et Lewis Trondheim.
« Poisson-Pilote, ce sera un peu L'Association en couleurs », entendait-on entre les travées du dernier festival d'Angoulême, avec un zeste de méchanceté. Annoncée et pensée depuis de nombreux mois, la nouvelle collection humour de Dargaud lancée -comme il se doit- ce 1er avril réunit en effet des signatures connues : Trondheim (bien sûr !), mais aussi Christophe Blain, David B, Joann Sfar... Il faut dire que l'éditeur parisien a très vite compris qu'il pouvait tirer parti du fait d'être le premier « grand » à aller chercher cette nouvelle génération d'auteurs alternatifs pour leur faire faire... à peu près la même chose en couleurs ! Ainsi est née la série Lapinot, qui a sûrement permis d'asseoir la notoriété de Trondheim. Ainsi est née « La révolte d'Hop-Frog », d'abord OVNI dans le catalogue de Dargaud et aujourd'hui récupérée (et rééditée) par Poisson-Pilote en attendant un deuxième épisode imminent (la série est rebaptisée « Hiram Lowatt & Placido »). Ainsi est né Merlin, l'irrésistible marmot dessiné par Munuera sur scénario de Sfar. Il y en a d'autres. Il y a même eu des albums en noir et blanc dans la collection Roman BD, mais on a bien senti que chez Dargaud, on laissait le N&B aux autres. Et qu'on tablait sur le grand public. Voici donc le premier album original de cette nouvelle collection « très Asso », qui louche tout de même aussi vers d'autres viviers (la présence de Larcenet (pilier de Fluide) et celle des frères Le Gall (Dupuis, Delcourt, etc...) le prouvent). Avec une volonté éditoriale affichée de faire de cette nouvelle collection une sorte de « fils illégitime » du Pilote de la grande époque, Dargaud vise très haut. Et les erreurs se payeront cash. N'ayant pas encore lu « Les petits contes noirs » à l'heure qu'il est, je ne peux tirer aucune conclusion sur la première salve de ces poissons-pilotes. Mais si autour d'Hop-Frog et de Lapinot ne gravitent que des albums aussi bons que ce « Cosmonautes du futur », rien à dire, Dargaud ne s'est pas planté. De là à y voir une filiation avec le Pilote des années Gosciny...
Alors, parlons-en, de ces cosmonautes du futur. Si les personnages trahissent la patte de Larcenet, on sent Lewis Trondheim derrière chacun des dialogues. Trondheim qui décidément soigne bien son adolescence introspective et solitaire en s'offrant de plus en plus d'albums à quatre mains (on pense à Blain et Sfar sur « Donjon », bien sûr). Les deux personnages centraux sont irrésistibles. Gildas est un petit garçon persuadé que le monde est peuplé d'Aliens recevant leurs ordres sur des téléphones portables. Il s'entraîne à les découvrir et à les exterminer. Martina, elle, est convaincue d'être la seule à savoir qu'elle est entourée de robots. La preuve : quand on les pince, les robots sont conditionnés à crier pour faire croire qu'ils ont eu mal. Ces deux-là ne pouvaient faire qu'une chose : se rencontrer. Et s'allier. Contre un monde d'envahisseurs, ils vont développer un langage secret, le bifteck (cela nous vaut quelques-uns des meilleurs moments de l'album, lors de conversations surréalistes au téléphone... qui rappellent les codes secrets de notre enfance). Et ils vont passer à l'action, avec ou sans la petite soeur qui n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Leur culot, leur ingéniosité, leur vocabulaire, tout est taillé sur mesure par Lewis Trondheim et Manu Larcenet pour nous les rendre sympathiques en diable et nous mener par le bout du nez vers... le bouquet final en forme de pied de nez ! Ne ratez pas cet album pétillant qui prouve que l'enfance est le monde dans lequel Trondheim excelle par dessus tout. Il en a gardé les clés et la logique. Ca se sent. A tel point qu'en le lisant, on redevient soi-même un enfant.