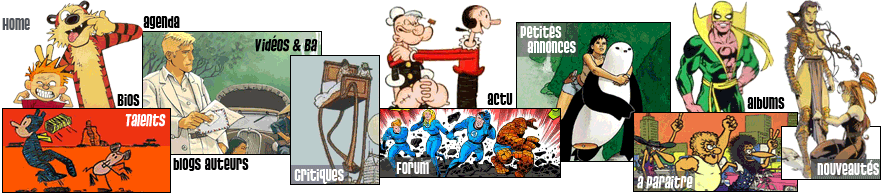Luna Almaden par Philippe Belhache 

"Luna Almaden", par Clarke et Lapiere, Dupuis Collection Aire Libre.
Quand Clarke, le dessinateur de Mélusine ou du désopilant Mr Président se met à faire de la bande dessinée réaliste, il y a tout lieu d'être surpris, tant cela ne correspond à priori pas à son style habituel. Et pourtant, habitué aux gags en une planche, Clarke se sort plutôt bien de cette histoire longue, s'étalant sur près de 60 planches. Son dessin est limpide, clair sans être simpliste, épuré, quitte parfois à paraître un peu léger sur les détails.
Il faut dire que pour ce coup d'essai, Clarke est aidé par un maître du genre, en la personne de Denis Lapiere, qui s'y entend en matière d'histoire généralement bien ficelée.
Pourtant, on ne peut s'empêcher de regretter ici un propos un peu léger. Cette histoire d'aveugle injustement accusée du meurtre de sa propre mère manque un peu de corps pour la faire tenir sur une aussi longue haleine. De plus, le noeud de l'intrigue repose sur quelques invraisemblances. Un peu dommage de la part de Lapière.
Restent les relations humaines... Et dans ce créneau, Lapiere s'y entend également particulièrement. La personnalité de Luna est particulièrement attachante et ne manque pas de crédibilité dans ses attitudes de non-voyante. Un comportement que Clarke s'efforce de rendre le plus réaliste possible : le regard qui passe au-delà de l'interlocuteur, l'alternance de quelques cases noires pour rendre le « point de vue » de Luna, le fait de ne pas allumer la lumière lorsqu'elle rentre chez elle... De ces petites choses qui fait que l'on croit au personnage sans pour autant rentrer totalement dans l'histoire. Ce qui n'est pas incompatible.
Par Laurent Fabri
Second avis : "Luna Almaden", par Clarke et Lapiere, Dupuis Collection Aire Libre.
Il est différent, et pourtant c'est toujours le même.. Clarke était déjà remarquable par sa capacité à adapter son style à toutes les formes de délire. Il réussit, avec « Luna Almaden », son passage à un univers réaliste, sans pour autant renier son style et ses fondamentaux. Ce premier album, noir à souhait, est à ce titre une réussite, encore mise en valeur par une superbe couverture. Pourtant, ce one-shot prometteur laisse le lecteur sur sa faim. Une insatisfaction difficile à analyser. Dérouler l'album du point de vue d'une aveugle était une bonne idée. Les deux auteurs ont travaillé à rendre prégnants son univers, sa solitude, à mettre en place une ambiance paranoïaque fondée sur le doute, en adoptant (avec succès) un rythme narratif volontairement lent et silencieux. Un rythme que vient casser un dénouement presque trop rapide. Au final, subsiste l'impression que l'on n'est pas allé assez loin, que la tension n'est pas montée assez haut. Mais l'intrigue pouvait-elle tenir vingt pages de plus sans sombrer dans la dilution ? Ajoutez à cela un « bug » dans le scénario - une aveugle peut-elle ne pas reconnaître la voix d'un proche ? - et on referme l'album. On se dit pourtant qu'il n'aurait pas fallu grand chose à cet album séduisant mais un peu bancal pour se faire un nom dans la cour des grands. Frustrant.