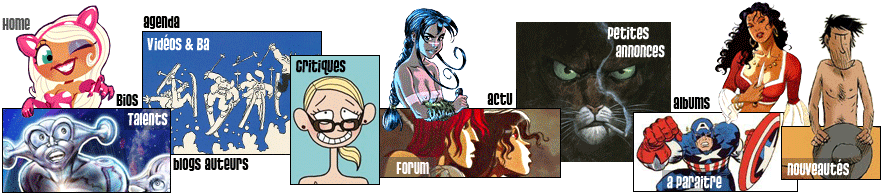"Le ciel lui tombe sur la tête", Astérix 33, par Albert Uderzo. Editions Albert René.
Stop, pitié, n'en jetez plus, arrêtez le massacre, c'est Goscinny qu'on assassine. Le dernier Astérix (pourvu que ce soit le dernier, faisait d'ailleurs remarquer un confrère) ne vaut pas tripette, affirmons-le d'emblée. Pis encore, il met à mal un mythe et le ridiculise purement et simplement.
Que le plus célèbre des Gaulois soit aux prises avec des extra-terrestres, cela n'est pas encore trop grave. Ne l'a-t-on pas vu faire plusieurs fois le tour du monde à une époque où la Méditerranée constituait le centre du monde connu, s'envoler sur des tapis volants et surtout boire à tour de bras une potion forcément magique. Le réalisme n'a jamais été le principe de la série et les auteurs ont toujours fait quelques entorses à la réalité historique pour les besoins du récit. Mieux même, ces décalages et ces anachronismes constituaient la plupart du temps les ressorts de l'humour.
Mais, cette "guerre des étoiles" dans le ciel du fameux village gaulois n'a rien de drôle, ni de captivant. Que du contraire. Ces extra-terrestres sont pathétiques dans leur représentation : entre le super héros à la tronche de Schwartzie, une sorte de croisement improbable entre un télétubbies et Mickey, de vieux restes de Goldorak et des robots volant au bruit de diesel, le "bestiaire" est limité et sans originalité.
Le scénario lui-même ne vaut guère mieux. Enfin.. Quel scénario ??? Est-on sensé voir une sorte de fable ou de métaphore dans la victoire des bons tadsylwiens sur les infâmes "nagmas" (il faut expliquer ou le sens des anagrammes n'aura pas échappé aux lecteurs assidus de BD Paradisio que vous êtes ?). Et l'on découvre donc, quasiment atterré, qu'Astérix est l'ami des comics américains plutôt que des méchants mangas japonais.
Les couleurs ? Nouveau coup de boutoir dans le bastion de la BD traditionnelle. Les à-plats sobres ont laissé la place à un ersatz de 3D, tentant sans doute de donner du relief à un album qui n'en a aucun. Rien à faire ! Sans vouloir afficher un passéisme nostalgique, la "colorisation" électronique ne sied absolument pas à ce type de dessin.
Car c'est sans doute la seule chose encore à sauver dans ce naufrage : le dessin d'Uderzo, celui des Gaulois, des Romains et des grandes baffes dans la gueule..? Ce style admirable qui n'a cessé de s'améliorer depuis les années 60. Mais tout bon dessinateur qu'il soit, Uderzo n'a pas le coup de crayon, ni l'imagination nécessaire pour se lancer dans la science-fiction.. C'est d'autant plus triste qu'Uderzo reste un monstre de la bande dessinée, une référence pour de nombreux auteurs et lecteurs.
A ce stade, le seul motif pour lequel on tourne encore la page, c'est pour voir, attristé jusqu'où ce pauvre Monsieur Uderzo va sombrer. Pour achever le dernier de nos mythes, en dédicace, Uderzo remercie Walt Disney de la potion magique dans laquelle tant d'auteurs de BD sont tombés. Et nous, pauvres lecteurs, qui croyions que la BD européenne trouvait ses racines dans nos vertes contrées, entre la Rue du Labrador, le Boulevard Tirou, ou la rédaction du journal Pilote.
A posteriori, on comprend mieux la machinerie marketing déployée pour préparer le lancement de cet album. Il en faudra du talent et du matraquage pour parvenir à fourguer plus de 8 millions de cette.. chose. Affligeant et consternant.
Par Laurent Fabri
Second avis : "Le ciel lui tombe sur la tête", Astérix 33, par Albert Uderzo. Editions Albert René.
Peut-on critiquer un mythe, une institution ? Une série dont la notoriété autorise un tirage total de huit millions d'exemplaire ? Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, Astérix reste l'une des bandes dessinées les plus populaires et les plus fédératrices qui soit. Il faut pourtant bien se rendre à l'évidence. Pour le lecteur un tant soit peu critique, le constat est amer. Ce nouvel opus des aventures du célèbre Gaulois développe une histoire totalement linéaire, au contenu manichéen, aux personnages vides de contenu, aux dialogues d'une grande platitude au regard du travail d'orfèvre effectué sur les albums de la grande époque. Uderzo s'amuse par anagrammes interposées d'une opposition simpliste entre de bons toons façon Disney et de méchants mangas stéréotypés (période Club Dorothée), le village franco-belge restant quoiqu'il arrive en résistance. Le pastiche tombe à plat, intellectuellement et graphiquement. Les gesticulations parodiques du Nagma apparaissent même bien pathétiques au regard d'expériences déjà anciennes, à l'image de l'hilarante prestation manga du Jérôme Moucherot de Bouq... Albert Uderzo reste un grand Monsieur, à la patte incontestable. Mais son approche semble aujourd'hui dépourvue de cette humanité qui faisait le succès de la série. A ce stade, on serait tenté de se dire que l'on a passé l'âge de lire Astérix. La reprise en main des anciens albums, à la magie intacte, efface rapidement cette idée. L'intérêt d'Astérix a toujours été de fédérer différentes générations de lecteurs autour d'un humour caustique, d'une grande finesse sous l'apparente gauloiserie. Dès lors, quelle explication donner ? Que l'esprit de Goscinny a définitivement disparu de la série ? On pourrait épargner à Uderzo ce poncif décliné sur tous les tons depuis le décès de son collaborateur et ami, s'il ne s'était lui-même érigé en gardien du temple. Tout en affirmant rester fidèle aux codes de la série, il ne fait que confirmer deux choses. Qu'un créateur graphique, tout formidable qu'il soit, ne fait pas forcément un bon scénariste. Et que l'humour de cet auteur bientôt octogénaire n'a plus rien d'universel. Le choix d'Uderzo de conserver le complet contrôle sur sa création est des plus respectables. Mais il est regrettable de voir une des séries qui a le plus contribué à la promotion de la bande dessinée franco-belge, à son accession au titre de média à part entière, retomber du statut de BD culte, légende du 9e art, à celui d'honnête illustré, même bien vendu. Inconscience ou saine ironie autocritique, Uderzo fait dire à Toune : "Afin de faire oublier cette aventure grotesque, je vais faire en sorte que les Gaulois n'en gardent aucun souvenir." La proposition est tentante. Sic transit gloria mundi.