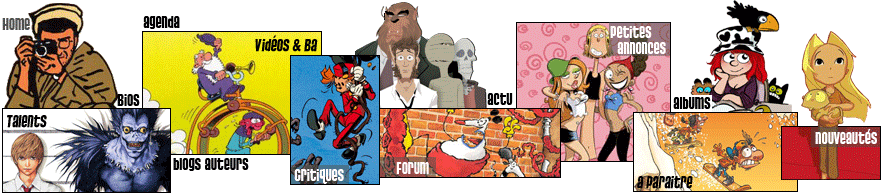Auschwitz par Thierry Bellefroid 

« Auschwitz » de Pascal Croci. Un album du label « Atmosphères » des éditions du Masque.
Publié à peu près au même moment que « Déogratias » (par Stassen, chez Aire Libre, Dupuis, voir critique par ailleurs), cet album sur Auschwitz frappe par son côté brut, presque documentaire. D'un côté, Stassen propose de mieux comprendre le génocide rwandais en créant un vrai récit de fiction, avec des enfants pour principaux protagonistes. Son but est de permettre au lecteur une certaine identification qui va entraîner un intérêt pour l'Histoire. De l'autre, la démarche de Pascal Croci est de combattre l'oubli avec un album dur, entièrement basé sur des témoignages réels, très peu « fictionnalisé », si l'on me permet ce néologisme. En dépit du temps et de l'énergie qu'il y a consacré, force est de constater que le résultat est moins probant. « Auscwhitz » reste un livre d'école, une BD pour professeurs de morale. Cela n'enlève rien à son talent graphique. Car Croci dessine remarquablement bien et donne à travers son noir et blanc une vision parfois plus effrayante que ne l'eût fait la couleur. Les décors rigoureusement reproduits, le souci du détail, le travail sur les gris : tout cela est remarquable. Mais on aime moins les regards exagérément agrandis pour insister sur l'horreur des camps, les phylactères aux formes tourmentées qui rappellent un peu les BD d'épouvante et surtout, ces personnages sans véritable histoire personnelle auxquels on ne peut que difficilement s'attacher. Outre le fait qu'il est difficile de croire que c'est à la fin de leur vie qu'un couple de rescapés se racontent mutuellement l'horreur des camps et la façon dont leur fille y a laissé la vie, le fait d'avoir placé ce récit en flash-back dans une guerre en ex-yougoslavie dont l'auteur n'exploite finalement que le nom paraît inutile. Bien sûr, l'idée est de dire que rien n'est fini et que l'Histoire peut se répéter. Mais à force de collectionner les bonnes intentions, on sabote son propre discours. C'est une peu ce qui apparaît à la lecture de cet album. Pascal Croci semble s'être laissé enfermer dans les souvenirs de ses témoins, comme s'il n'avait plus eu le droit de faire une vraie fiction. Cela manque d'humanité. Le regard est froid, clinique, extérieur. On est loin de films qui ont ému comme « La liste de Schindler » ou, dans un registre plus discuté mais pas moins efficace, « La vie est belle ». Bref, si j'ai frissonné plus d'une fois en lisant cet album (certaines scènes sont vraiment très fortes. Notamment, les pages 45-55 qui constituent véritablement le pivot et le coeur de ce récit, lorsque le héros, Kazik, doit entrer dans la chambre à gaz encore fumante pour en enlever les corps), je suis resté sur un malaise. L'impression que vouloir faire une fiction réaliste a finalement moins d'impact sur le lecteur que le « Maus » de Spiegelman, avec ses souris et ses chats dans la situation des Juifs et des Allemands. Mais cet avis peut-être un peu sévère ne doit pas masquer le fait que « Auscwhitz » est une oeuvre utile (s'il l'est ne fût-ce que dans les classes d'école, c'est déjà gagné, non ?) et courageuse. Croci s'est manifestement très bien documenté et beaucoup investi, ce qui est d'autant plus remarquable qu'il n'est pas Juif lui-même ; il a simplement voulu témoigner d'une réalité de son siècle. La lecture de l'album ne laissera pas indifférent. J'ai simplement peur que l'option retenue n'éloigne une partie du public et notamment la cible principale : les plus jeunes.