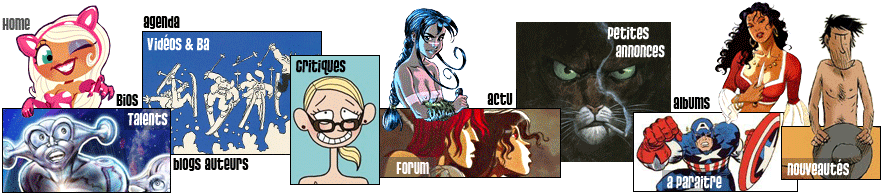Lune de guerre par Thierry Bellefroid 

« Lune de guerre », par Van Hamme et Hermann, dans la collection « Aire Libre » des éditions Dupuis.
Dupuis crée l'événement dès les premiers jours de 2000 avec un one-shot réunissant deux des plus grandes stars de la BD francophone actuelle. Le résultat est réussi et séduira sans doute bon nombre de lecteurs, ce qui permettra au passage d'asseoir plus encore la notoriété de la collection Aire Libre.
« Lune de guerre », c'est du sur-mesure pour Hermann. Plus encore qu'à l'accoutumée, on dirait que Jean Van Hamme a travaillé son scénario pour correspondre à son dessinateur. Résultat, l'histoire sonne comme du Greg de la grande époque, que ce soit dans ses personnages dominateurs à l'allure taurine ou son crescendo tragique. Van Hamme le confesse en avant-propos, « Lune de guerre » doit son origine à une anecdote, glanée il y a une dizaine d'années à un repas mondain. Au cours d'une noce, un différent oppose le père du marié au restaurateur, à qui l'on reproche de servir des tomates crevettes d'une fraîcheur approximative. Le père du marié n'arrivant pas à se mettre d'accord avec le propriétaire du restaurant, se propose d'emmener tout son petit monde déjeuner ailleurs. Voyant son chèque lui échapper, le restaurateur enferme alors la mariée dans les toilettes et refuse de la libérer tant qu'il ne reçoit pas son argent. Dans l'histoire originale, tout le monde revient à table et la journée s'achève sans autre incident. Plus machiavélique, Van Hamme y donne une autre suite. D'abord, il fait séquestrer la belle-mère en plus de la mariée, histoire de provoquer la colère du père du marié et de jouer, plus tard, sur les relations délicates entre les deux femmes. Ensuite, il conçoit un drame particulièrement musclé qui se déroule sur quelques heures à peine, prétexte rêvé à une étude de caractères bien trempés.
Dans ce qui commence comme une partie de bras de fer entre un propriétaire terrien autoritaire et un restaurateur qui ne veut perdre ni la face ni son argent, Jean Van Hamme injecte ce qu'il faut de dérapages pour que l'affaire vire au drame. Et on se prend au jeu. Avec des personnages tels qu'ils sont présentés dans « Lune de guerre », ce genre de situation est tout à fait plausible. Bien sûr, des familles comme les Maillard ne courent pas les rues. Un peu d'auto-suggestion est nécessaire pour y croire. Mais ensuite, tout s'enchaîne avec brio. Les personnages principaux, mais aussi secondaires sont tous plus que des acteurs du drame : ils ont une histoire, une épaisseur, des petits secrets qui vont transparaître au fil des pages et, parfois, cristalliser les haines qui se sont données rendez-vous dans ce petit coin d'Ardennes. Les célèbres fiches qu'établit Jean Van Hamme sur ses personnages en marge de ses scénarios n'ont peut-être jamais paru si utiles au récit que dans ce « Lune de guerre ».
Et Hermann, dans tout ça ? Il se sent comme un poisson dans l'eau, bien sûr. Lui qui se fait tirer l'oreille pour travailler sur les scénarios des autres semble avoir plongé dans « Lune de guerre » avec un réel plaisir. En revanche, si on a l'impression que Van Hamme a tout fait pour ne pas faire « du Van Hamme », Hermann, lui, n'a rien changé à son dessin. Tous les visages ont un air de déjà vu et les femmes sont toujours aussi peu à leur avantage. Quant aux couleurs directes -le véritable plaisir d'Hermann depuis Sarajevo-Tango réalisé il y a quatre ans pour la même collection Aire Libre-, elles semblent très pales, parfois même presque délavées. Une tendance qui s'amorçait déjà dans les derniers travaux du dessinateur et qui semble correspondre à sa nouvelle vision de la couleur. Elle en désarçonnera sans doute plus d'un. Plus réussies, presque parfaites, même, les scènes de nuit (et plus encore l'incendie final) prouvent une réelle maîtrise de l'aquarelle et de la lumière indirecte. Quant à l'action, rien à dire, c'est le fond de commerce d'Hermann. Peu d'autres dessinateurs peuvent le concurrencer dans ce domaine.
En résumé, « Lune de guerre » est un bel album, qui prouve que Jean Van Hamme n'est jamais aussi bon que lorsqu'il évite les séries (on pense au « Grand pouvoir du Chninkel », à « S.O.S Bonheur », à « Histoire sans héros », etc...). Et même si on ne peut parler ici de chef-d'oeuvre, il convient de rappeler que le scénariste de XIII, Largo Winch, Thorgal et autres Maîtres de l'orge est si coutumier des succès de librairie que la critique en oublie parfois de souligner ses qualités. Voilà qui devait être dit !