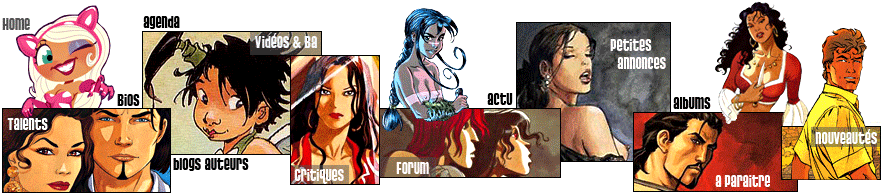"Le prophète", nouvel album de Lucky Luke, par Patrick Nordmann et Morris, chez Lucky Comics.
Quelques jours après la mort de Will, cet album vient rappeler une dure réalité : Morris est le dernier survivant de « la bande des quatre » (Franquin, Jijé, Will et Morris), ce quatuor qui a révolutionné la BD franco-belge d'après-guerre. Bien sûr, Will ne publiait plus depuis quelque temps déjà, mais le savoir parti fait de ce nouveau Lucky Luke un objet particulier. On a souvent demandé à Morris comment il avait pu passer sa vie entière à dessiner le même héros. Inlassablement, il a répondu « parce que ça m'amuse ». Et on est tenté de le croire, même si avec les années, les personnages ont commencé à montrer quelques tics et les décors à se simplifier à l'extrême.
Autre élément d'actualité lié à la sortie de cet album, le changement d'éditeur. Après dix ans d'existence, Lucky Production passe la main à Lucky Comics, ce qui équivaut plus ou moins à un retour chez Dargaud (même s'il s'agit d'une association et non d'une appropriation !). Après avoir perdu son procès contre Albert Uderzo, l'éditeur français a en effet renoué le contact avec Morris et trouvé les mots pour le convaincre. Les lecteurs ne verront sans doute pas le changement. N'empêche, la machine Dargaud récupère ainsi le cow-boy qui tire plus vite que son ombre et il faut s'attendre à une offensive en terme de communication et marketing, offensive à laquelle le ronronnant éditeur Lucky Production ne nous avait pas habitués. Si l'on regarde en arrière, on s'aperçoit que les changements d'éditeurs de cette série ont souvent été déterminants. Même si les premiers albums de la seconde période sont excellents (je pense au « Pied Tendre » ou à « La caravane », par exemple), la plupart des nostalgiques vous diront qu'ils ne jurent que par la période Dupuis. Et la chute de régime s'accentue encore lorsque Lucky Production remplace Dargaud. Bref, après plus d'un demi-siècle d'existence, Lucky Luke joue peut-être sa seconde jeunesse.
Parlons de l'album, maintenant. Scénarisé par un journaliste suisse, Patrick Nordmann, il nous emmène dans le petit monde des communautés religieuses qui ont tenté d'essaimer (certaines avec succès, d'ailleurs) dans l'Ouest américain. « Le prophète » est un détenu, Dunkle, qui va évidemment réussir sans peine à entraîner dans son sillage le plus bel imbécile que la BD ait créé : Averell Dalton. Et pendant que le plus « haut » des frères joue les disciples parfaits, les trois autres découvrent avec stupéfaction une ville où la violence et l'argent n'existent pas. Sans parler des saloons, remplacés par des salons de thé où l'on boit de la verveine ! La caricature est évidemment poussée à l'extrême, et les Dalton, bêtes et cupides comme on les connaît, ne loupent pas l'occasion de renverser l'ordre établi. Rien que de très attendu et conventionnel, mais ça fonctionne. Lucky Luke joue son rôle à la virgule près mais finit par devenir un personnage secondaire de sa propre série. Quant à la fin, elle est un peu expédiée, alors même que certains passages sont tirés en longueur dans le reste de l'album. Bref, ce « Prophète » est un album honnête, surtout si on le compare à la plupart de ses prédécesseurs. Mais n'en espérez pas davantage. Et si vos enfants découvrent Lucky Luke grâce à lui, n'hésitez pas à profiter de l'occasion pour leur faire découvrir l'âge d'or de la série, ils en redemanderont.