 |
 |
Chris
Lamquet répond aux questions de Thierry Bellefroid pour BD Paradisio
dans le cadre de la série Alvin
Norge, publiée dans la collection Troisième Vague
du Lombard. |
 Par
où commencer ? Gilles Roux et Marie Meuse ? Par
où commencer ? Gilles Roux et Marie Meuse ?
Chris Lamquet : Non, on ne va pas
remonter si loin, si ?
Quoi, c'est une page honteuse de ton histoire
?
Chris Lamquet : Non, pas du tout
mais c'est tellement loin.
Spirou ?
Chris Lamquet : C'est un passage
obligé quelque part. Gilles Roux et Marie Meuse, c'est un peu la continuité
de l'époque où j'étais assistant. Même esprit, même univers graphique,
un peu comme un péché de jeunesse, quoi.
Péché de jeunesse. Ce qui veut dire que
tu y vois beaucoup de défauts aujourd'hui ?
Chris Lamquet : Oui, oui, tout à
fait. Au niveau scénario, ça c'est clair que les constructions sont trop
impulsives ; ça manque de rigueur. Il y avait de bonnes idées mais qui
n'ont pas été bien exploitées, je crois. Mais bon, il y a eu 4/5 bouquins,
je crois, la cinquième a été publiée dans Tintin, à la dernière époque
où il s'appelait encore Tintin, voilà, pas de regrets.
Pas de regrets.
 Chris
Lamquet : Non, pourquoi en aurais-je ? Mais disons que si l'on
devait reprendre ça en mains maintenant, il y aurait un lifting plus que
radical. Au niveau du graphisme d'abord - ce serait plutôt la part de
Magda. Au niveau de l'univers dans lequel évoluent les personnages, aussi,
qui serait plus contemporain parce qu'il faut bien dire que c'étaient
des aventuriers mais un peu obsolètes dans leur façon de voir la vie,
etc. Et peut-être enfin au niveau du rapport homme-femme, qui était peut-être
une des originalités de la série, mais qui était un peu éludé dans ce
qu'on faisait ; ça c'est vraiment parce que Tintin à l'époque ne voulait
pas que l'on en parle. Il fallait passer ça sous silence et axer sur l'exotisme,
l'aventure, etc. Moi, j'aimerais bien, justement, mettre en scène un couple
d'aventuriers, qui non seulement auraient des Aventures mais aussi des
aventures (personnelles, etc.) qui influeraient sur les Aventures. Cela
pourrait être une démarche intéressante. Chris
Lamquet : Non, pourquoi en aurais-je ? Mais disons que si l'on
devait reprendre ça en mains maintenant, il y aurait un lifting plus que
radical. Au niveau du graphisme d'abord - ce serait plutôt la part de
Magda. Au niveau de l'univers dans lequel évoluent les personnages, aussi,
qui serait plus contemporain parce qu'il faut bien dire que c'étaient
des aventuriers mais un peu obsolètes dans leur façon de voir la vie,
etc. Et peut-être enfin au niveau du rapport homme-femme, qui était peut-être
une des originalités de la série, mais qui était un peu éludé dans ce
qu'on faisait ; ça c'est vraiment parce que Tintin à l'époque ne voulait
pas que l'on en parle. Il fallait passer ça sous silence et axer sur l'exotisme,
l'aventure, etc. Moi, j'aimerais bien, justement, mettre en scène un couple
d'aventuriers, qui non seulement auraient des Aventures mais aussi des
aventures (personnelles, etc.) qui influeraient sur les Aventures. Cela
pourrait être une démarche intéressante.
Alors vingt ans ont passé à peu près et
nous voici avec un héros je ne vais pas dire « futuriste » mais « bien
de son temps ». Et c'est peut-être même ce qui correspond le plus - et
ce n'est pas un jugement -- au terme Troisième Vague depuis que la collection
a été lancée.
Chris Lamquet : Oui, c'est peut-être
parce que justement on parle du virtuel, d'Internet, etc. C'est vrai qu'il
y a un aspect « troisième millénaire », qui n'est pas vraiment voulu.
Moi je crois que je suis arrivé dans la Troisième Vague au bon moment,
c'est un coup de chance : ça n'a pas été réfléchi. Il se fait que je correspondais
à l'époque à ce que les éditeurs envisageaient de faire avec la Troisième
Vague. C'est ce qui explique que le sujet a été pris. Maintenant la Troisième
Vague ne va pas être que du modernisme ou des histoires contemporaines.
Ca va aussi être - on le voit avec Capricorne - des univers complètement
différents mais qui auront peut-être effectivement comme fil conducteur
apparent le fait que l'on soit dans le contemporain ou dans le futur.
Pourtant, je crois que le vrai fil conducteur de la collection, c'est
un ton et les sujets abordés qui sont peut-être, eux, effectivement plus
Troisième Vague. Mais je ne connais pas les secrets éditoriaux du Lombard.
 Ce
qui m'amuse, en revanche, c'est que tu travailles actuellement sur deux
séries, l'une chez Glénat, le Pithécantrope, et celle-ci au Lombard, Alvin
Norge. L'une tournée résolument vers le passé, qui est le chaînon manquant,
et l'autre résolument vers l'avenir, qui est la société de communication
virtuelle. C'est un pur hasard ? Ou cela répond à une envie d'exotisme
temporel ? Ce
qui m'amuse, en revanche, c'est que tu travailles actuellement sur deux
séries, l'une chez Glénat, le Pithécantrope, et celle-ci au Lombard, Alvin
Norge. L'une tournée résolument vers le passé, qui est le chaînon manquant,
et l'autre résolument vers l'avenir, qui est la société de communication
virtuelle. C'est un pur hasard ? Ou cela répond à une envie d'exotisme
temporel ?
Chris Lamquet : Non, c'est un pur
hasard. Le Pithécantrope, c'est une erreur parce qu'à l'origine, c'est
un scénario que j'avais écrit pour quelqu'un d'autre et il se fait que
cela ne s'est pas fait. J'avais besoin de boulot et, le scénario existant,
je me suis engouffré dedans. Donc je me suis trouvé confronté à un univers
que je ne maîtrisais pas bien, graphiquement en tout cas, parce que c'est
un univers que je n'avais jamais mis en scène. Ce qui m'a le plus plu,
c'est le côté dialogue, côté un peu veau-de-villesque, etc. Là vraiment
je me suis éclaté.
C'est du théâtre.
Chris Lamquet : Oui, complètement.
C'est vraiment conçu comme tel et c'est peut-être là que le bas blesse.
C'est-à-dire que j'ai plus mis l'accent sur l'aspect « Woody Allen »,
des rapports entre les personnages.
Et avec la guenon aussi...
 Chris
Lamquet : Oui, c'est carrément loufoque. Mais peut-être trop.
Je crois que les gens qui aiment l'historique sont à priori des gens qui
aiment bien quelque chose de bien planté, de bien défini, d'historique
au sens propre du mot. Là je dois bien reconnaître qu'avec l'Histoire,
j'ai fait le grand écart. Effectivement, on est fin 19ème mais je n'illustre
pas la fin du 19ème dans les Indes néerlandaises, ce n'était pas du tout
mon propos. C'était de montrer justement des gens du Nord qui vivaient
dans un pays tropical entourés d'animaux. C'est un peu ça le principe
de l'orang-outang. Pour moi l'orang-outang, c'est un peu ce personnage
dans la Comedia del Arte, qui est sur le côté de la scène et qui fait
des commentaires sur tout ce qui se passe sur la scène. Lui, il les mime
évidemment, et parfois de façon un peu scabreuse. Enfin tout ça fait que
c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé faire. Mais il faut bien reconnaître
que commercialement ça n'a pas été ça. Chris
Lamquet : Oui, c'est carrément loufoque. Mais peut-être trop.
Je crois que les gens qui aiment l'historique sont à priori des gens qui
aiment bien quelque chose de bien planté, de bien défini, d'historique
au sens propre du mot. Là je dois bien reconnaître qu'avec l'Histoire,
j'ai fait le grand écart. Effectivement, on est fin 19ème mais je n'illustre
pas la fin du 19ème dans les Indes néerlandaises, ce n'était pas du tout
mon propos. C'était de montrer justement des gens du Nord qui vivaient
dans un pays tropical entourés d'animaux. C'est un peu ça le principe
de l'orang-outang. Pour moi l'orang-outang, c'est un peu ce personnage
dans la Comedia del Arte, qui est sur le côté de la scène et qui fait
des commentaires sur tout ce qui se passe sur la scène. Lui, il les mime
évidemment, et parfois de façon un peu scabreuse. Enfin tout ça fait que
c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé faire. Mais il faut bien reconnaître
que commercialement ça n'a pas été ça.
Tu en parles avec une certaine amertume
?
Chris Lamquet : Oui, parce qu'on
y a cru... Editeur, auteur, on y a cru. Au premier album, Jacques Glénat
y croyait vraiment. Parfois, on met ses espoirs dans des choses qui n'aboutissent
pas et ça a été le cas donc moi j'étais partisan de ne même pas faire
le deuxième ; j'étais tellement déçu du « couac » du premier qu'à priori
j'étais partant pour ne pas continuer. J'ai fait le deuxième, je ne pense
pas qu'on ira au-delà. Ou alors le succès de Norge va peut-être entraîner
le reste dans son sillage. On verra bien.
 Graphiquement,
c'est quand même ta seule ou ta première BD en couleurs directes, si l'on
peut employer ce terme ici. Graphiquement,
c'est quand même ta seule ou ta première BD en couleurs directes, si l'on
peut employer ce terme ici.
Chris Lamquet : Oui, dans la mesure
où on peut appeler le numérique de la couleur directe. En fait c'est vrai
que la technique de travail a influé sur l'aspect général de l'album.
Dans le cas d'un sujet comme Norge, je crois qu'il est indispensable d'être
en accord entre le fond et la forme. Je veux dire par là que pour traiter
ce sujet-là - le fond - je ne pouvais pas techniquement le traiter de
façon traditionnelle comme je l'ai fait avec le Pithécantrope par exemple.
Je crois que le rendu -la texture comme on dirait en 3D- de l'histoire
n'aurait pas fait passer les images numériques. Or comme tout joue là-dessus,
c'est-à-dire sur cette différence entre la réalité et le numérique, et
sur cette intrusion d'une image numérique dans le quotidien, il fallait
que je passe par le numérique pour le dessin. Une grosse partie du travail
de cet album a été numérisée, travaillée directement à l'écran, on peut
dire en couleurs directes finalement mais j'ai envie de dire plutôt en
pixels directs. D'ailleurs l'histoire devait s'appeler initialement «
Kimberly a de jolis pixels ». Moi j'aimais bien ce titre-là mais les commerciaux
ont trouvé que cela faisait un peu nunuche.
Et, pour revenir au Pithécantrope, tu travaillais
là de manière purement traditionnelle.
Chris Lamquet : Oui, on fait les
planches, on les cliche et on tire des bleus. Donc les couleurs étaient
faites sur bleu.
Mais très exigeantes alors, parce qu'elles
étaient vraiment très soignées.
 Chris
Lamquet : Oui, c'est-à-dire que pour le premier, je les ai
faites moi-même, avec parfois une surenchère dans les effets de lumière,
etc. et pour le deuxième, j'avais fait appel à un coloriste. Je trouve
que ça colle bien, c'est-à-dire que si j'avais traité le Pithécantrope
en numérique, la texture n'aurait pas collé. Il y a une saturation dans
les couleurs et une luminosité, dans le numérique, qui ne colle pas au
19ème. Je crois qu'il faut un côté « fait main », un côté « coups de pinceau
». Chris
Lamquet : Oui, c'est-à-dire que pour le premier, je les ai
faites moi-même, avec parfois une surenchère dans les effets de lumière,
etc. et pour le deuxième, j'avais fait appel à un coloriste. Je trouve
que ça colle bien, c'est-à-dire que si j'avais traité le Pithécantrope
en numérique, la texture n'aurait pas collé. Il y a une saturation dans
les couleurs et une luminosité, dans le numérique, qui ne colle pas au
19ème. Je crois qu'il faut un côté « fait main », un côté « coups de pinceau
».
Alors, parlons d'Alvin Norge. Première chose,
est-ce que l'on peut dévoiler le nombre d'épisodes prévus pour le dénouement
de l'affaire ?
Chris Lamquet : On ne peut pas vraiment
parler de cycles. Je crois que l'histoire va continuer tout en ayant comme
à priori que chaque album en soi aura bouclé son contenu. C'est-à-dire
que je ne vais pas faire de suite en deux ou trois volumes. Les sujets
vont être rémanents parce qu'ils vont s'inclure dans le quotidien de Norge
et dans tout ce qui lui arrive mais la volonté n'est pas de faire un cycle
de deux qui traite de ça, un cycle de trois qui traite de ça. Ce sera
plutôt une continuité dans le temps et les sujets vont se télescoper mais
je vais quand même essayer de construire mes albums - en tout cas le deuxième
est construit de cette façon-là - en sorte qu'on puisse les lire sans
faire référence au précédent.
 D'où
vient l'idée du scénario ? On a l'impression que tu connais bien ce dont
tu parles. Tu n'es peut-être pas un hacker mais un internaute ou un utilisateur
fervent de l'informatique, non ? D'où
vient l'idée du scénario ? On a l'impression que tu connais bien ce dont
tu parles. Tu n'es peut-être pas un hacker mais un internaute ou un utilisateur
fervent de l'informatique, non ?
Chris Lamquet : De toute façon si
j'étais un hacker, je ne m'en vanterais pas, ça c'est déjà une chose.
L'informatique, ça remonte à quatre ans à la maison. Tout d'un coup cet
objet est apparu dans la pièce mais à l'origine, c'était essentiellement
pour les enfants. Ils jouaient là-dessus. Et puis j'en ai eu besoin pour
des raisons pratiques : il fallait que j'envoie du matériel assez loin
donc j'ai commencé à utiliser la messagerie électronique. Mais de plus
en plus cette machine prenait de l'importance dans ma maison et devenait
un individu à part entière. C'est-à-dire que, que ce soit moi ou mes fils
ou ma femme, nous l'allumions assez instinctivement pour diverses tâches
et cet appareil, qui à priori était un appareil uniquement gadget, a pris
une place en tant qu'outil, en tant que compagnon de jeu, etc. C'est un
sentiment qui m'a un peu troublé au départ. Je me suis dit « Voilà un
engin qui à priori, si on le laisse faire, va nous rendre complètement
dépendants. » Puis j'ai découvert que l'on pouvait y introduire de nouveaux
logiciels, que l'on pouvait faire pas mal de choses au niveau dessin et
là j'ai été piqué au vif. J'ai cherché, effectivement, à me développer,
à comprendre tous ces logiciels, à savoir les maîtriser, etc. Et c'est
devenu, après un certain temps, un outil vraiment indispensable. Le temps
passant, l'idée s'est imposée à moi de mettre en scène un personnage qui,
justement, était confronté perpétuellement à cette machine et à tous ses
pouvoirs, toutes ses possibilités, mais aussi tous ses travers - dans
le cas de Norge, ce serait plutôt tous ses travers.
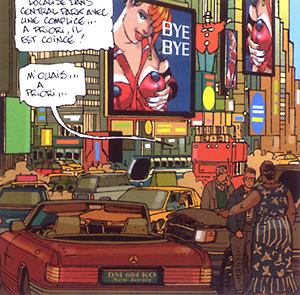 L'idée
de Norge est venue comme ça, en fait. C'est l'envie de projeter mon sentiment
vis-à-vis de cette machine au travers d'un personnage. Comme j'aime New
York, j'ai décidé que j'allais planter les décors à New York, donc d'en
faire un New Yorkais, ce qui m'a arrangé parce que c'est un personnage
plutôt cool, qui encaisse les choses dans un premier temps de façon relativement
sereine et puis qui cherche quand même à les résoudre. Mais l'informatique
n'est pas chez moi obsessionnelle. Il y a tout simplement un constat qu'à
partir du moment où elle rentre dans une maison, c'est un peu comme la
télévision, ça devient un outil incontournable. Et je fais aussi souvent
ce parallèle de l'apparition de la photographie à l'époque des peintres
du 19ème siècle : au début ça a été un peu marginal et puis, tout doucement,
ce qu'on a cru qui allait supplanter la peinture, finalement, l'a aidée.
Dans le domaine de la BD, c'est un peu le même phénomène : l'ordinateur
a sa place en tant qu'outil. Et, à partir du moment où on utilise cet
outil-là, on raconte des histoires qui utilisent les fonctions de cet
outil. Norge en est une, évidemment. C'est l'aboutissement de tout ça,
c'est cette découverte de la machine en tant qu'outil. C'est l'application
aussi d'un savoir-faire que j'avais acquis en faisant du manga ou de l'animation.
Il y avait cette envie d'utiliser ce « matériau ». L'utiliser au travers
d'une série comme le Pithécantrope était impossible. Il fallait créer
un sujet qui utilise, comme une éponge, toutes ces technologies-là. L'idée
de Norge est venue comme ça, en fait. C'est l'envie de projeter mon sentiment
vis-à-vis de cette machine au travers d'un personnage. Comme j'aime New
York, j'ai décidé que j'allais planter les décors à New York, donc d'en
faire un New Yorkais, ce qui m'a arrangé parce que c'est un personnage
plutôt cool, qui encaisse les choses dans un premier temps de façon relativement
sereine et puis qui cherche quand même à les résoudre. Mais l'informatique
n'est pas chez moi obsessionnelle. Il y a tout simplement un constat qu'à
partir du moment où elle rentre dans une maison, c'est un peu comme la
télévision, ça devient un outil incontournable. Et je fais aussi souvent
ce parallèle de l'apparition de la photographie à l'époque des peintres
du 19ème siècle : au début ça a été un peu marginal et puis, tout doucement,
ce qu'on a cru qui allait supplanter la peinture, finalement, l'a aidée.
Dans le domaine de la BD, c'est un peu le même phénomène : l'ordinateur
a sa place en tant qu'outil. Et, à partir du moment où on utilise cet
outil-là, on raconte des histoires qui utilisent les fonctions de cet
outil. Norge en est une, évidemment. C'est l'aboutissement de tout ça,
c'est cette découverte de la machine en tant qu'outil. C'est l'application
aussi d'un savoir-faire que j'avais acquis en faisant du manga ou de l'animation.
Il y avait cette envie d'utiliser ce « matériau ». L'utiliser au travers
d'une série comme le Pithécantrope était impossible. Il fallait créer
un sujet qui utilise, comme une éponge, toutes ces technologies-là.
On a l'impression qu'au plan scénaristique,
il y a une volonté de rigueur.
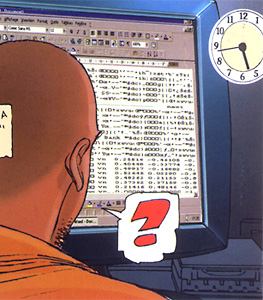 Chris
Lamquet : Oui, absolument. Au départ, c'est un story-board,
en fait. C'est une technique que j'utilise depuis maintenant quelques
années. Avant que l'album ne commence à être dessiné, tout le story-board
est fait, ce qui permet, un peu comme un puzzle, de recomposer les scènes,
de mettre certaines scènes plus en avant, de faire un réel travail de
montage avant même d'avoir tourné le film en quelque sorte. Ce qui fait
qu'à partir du moment où le premier coup de crayon est donné, je sais
exactement ce qu'il y à la troisième case de la planche 44. C'est un souci
de construction qui a deux finalités : arriver à caser tout en 46 planches,
ce qui n'est pas évident et, deuxièmement, c'est le souci d'avoir un langage
plus proche du cinéma, parce que j'utilise un outil, l'ordinateur, qui
me rapproche des techniques cinématographiques. On rentre directement
dans l'action, on ne joue pas trop d'histoires parallèles, on met la caméra
au cul du personnage principal et on ne le lâche plus, de façon à ce qu'il
y ait une continuité et une identification permanente dans l'histoire.
Cela revient à éviter de faire ce que je faisais systématiquement avant,
une multitude d'histoires qui finissent par s'entrechoquer et s'entrecouper
; c'est très amusant au niveau construction narrative mais au niveau lecture,
c'est un peu lourd. Pour être simple, en abordant un sujet qui n'est pas
facile à faire passer, j'ai essayé de permettre aux gens qui n'ont jamais
touché un ordinateur de comprendre. Je ne pouvais pas m'embarquer dans
des explications techniques, ça ne servait strictement à rien. Il fallait
que je joue le candide et que je raconte cette histoire comme quelqu'un
qui n'y connaîtrait rien en informatique, d'où la rigueur effectivement. Chris
Lamquet : Oui, absolument. Au départ, c'est un story-board,
en fait. C'est une technique que j'utilise depuis maintenant quelques
années. Avant que l'album ne commence à être dessiné, tout le story-board
est fait, ce qui permet, un peu comme un puzzle, de recomposer les scènes,
de mettre certaines scènes plus en avant, de faire un réel travail de
montage avant même d'avoir tourné le film en quelque sorte. Ce qui fait
qu'à partir du moment où le premier coup de crayon est donné, je sais
exactement ce qu'il y à la troisième case de la planche 44. C'est un souci
de construction qui a deux finalités : arriver à caser tout en 46 planches,
ce qui n'est pas évident et, deuxièmement, c'est le souci d'avoir un langage
plus proche du cinéma, parce que j'utilise un outil, l'ordinateur, qui
me rapproche des techniques cinématographiques. On rentre directement
dans l'action, on ne joue pas trop d'histoires parallèles, on met la caméra
au cul du personnage principal et on ne le lâche plus, de façon à ce qu'il
y ait une continuité et une identification permanente dans l'histoire.
Cela revient à éviter de faire ce que je faisais systématiquement avant,
une multitude d'histoires qui finissent par s'entrechoquer et s'entrecouper
; c'est très amusant au niveau construction narrative mais au niveau lecture,
c'est un peu lourd. Pour être simple, en abordant un sujet qui n'est pas
facile à faire passer, j'ai essayé de permettre aux gens qui n'ont jamais
touché un ordinateur de comprendre. Je ne pouvais pas m'embarquer dans
des explications techniques, ça ne servait strictement à rien. Il fallait
que je joue le candide et que je raconte cette histoire comme quelqu'un
qui n'y connaîtrait rien en informatique, d'où la rigueur effectivement.
 On
a l'impression - on ne connaît pas encore grand chose du dénouement de
l'histoire - que la personnalité du fameux tueur, dont on a découpé le
cerveau en rondelles et mis sur un disque dur, a quelque chose à voir
avec les derniers héros, depuis une dizaine d'années surtout, serial killers,
la vague américaine, le Silence des Agneaux, etc. Tu as été influencé
par toute cette série de héros psychopathes sans avoir voulu en faire
nécessairement une copie ? On
a l'impression - on ne connaît pas encore grand chose du dénouement de
l'histoire - que la personnalité du fameux tueur, dont on a découpé le
cerveau en rondelles et mis sur un disque dur, a quelque chose à voir
avec les derniers héros, depuis une dizaine d'années surtout, serial killers,
la vague américaine, le Silence des Agneaux, etc. Tu as été influencé
par toute cette série de héros psychopathes sans avoir voulu en faire
nécessairement une copie ?
Chris Lamquet : Sûrement, c'est clair.
Influencé par l'actualité d'abord mais aussi et surtout -- je suis assez
américanophile au niveau cinéma -- par toute une série de films ces dernières
années. Je pense à Seven, évidemment, des trucs de ce genre. Et là c'est
vrai que je suis complètement baigné là-dedans. Non seulement parce que
ce sont des films qui m'ont frappé en tant que spectateur mais je me les
suis repassés justement pour comprendre un peu le travail scénaristique
qui est là derrière et qui bien souvent est d'une construction géniale.
C'est vrai qu'il y a une influence directe du cinéma américain. Je ne
le cache pas du tout. A la limite même, je le revendique. Disons que c'est
une BD construite à l'américaine plutôt qu'à la française.
Alors, au niveau du look je suis étonné
parce que c'est le deuxième héros de la collection que je trouve très
looké « années 2000. » Comme Niklos Koda, il y a un travail sur la barbe,
sur la pilosité, il y a le bonnet aussi. C'est une obligation pour entrer
dans la Troisième Vague pour être crédible, pour faire des histoires modernes.
On commence à faire des castings ?
 Chris
Lamquet : Oui, ça c'est sûr, on fait des castings. C'est vrai
que quand j'ai créé Norge, plutôt que de me laisser aller à créer un personnage
qui serait vraiment original ou décalé de son temps pour le rendre justement
plus original, j'ai pris le parti-pris de l'archétype, l'archétype toujours
influencé par le cinéma américain. C'est Bruce Willis, le bonnet et la
veste de cuir flottante. Mais c'est vrai que ce sont des images que j'avais
envie de retranscrire et ça m'arrangeait parce que par son look le personnage
donne son comportement : cette attitude qu'il a avec ce bonnet ou ses
mains en poche est aussi parlante que de le faire parler lui-même. Donc
là, on est dans l'image d'Epinal. Et la bande dessinée, c'est ça en fait,
c'est très réducteur, la BD. Il faut dès la première case qu'on ait compris
le personnage. S'il faut commencer psychologiquement à développer comme
j'ai pu le faire dans un bouquin comme l'Amour hologramme chez Casterman
- mais là j'avais la place, j'avais 130 planches - , on en sort pas. Ici,
il faut en 46 planches typer des personnages de façon très simple, mais
efficace au niveau. Norge est typé justement pour qu'on sente le côté
cool, New Yorkais. Olga, la Russe, est typée comme une fille actuelle
avec son nombril à l'air. Ce sont des archétypes, je sais bien, mais c'est
efficace et, à la limite, le fait d'être débarrassé du souci de rendre
crédible le personnage par des tas d'artifices me permet de me défouler
au niveau scénario. Je suis libéré de l'aspect graphique du personnage
et je me défoule dans les dialogues. Donc c'est narrativement beaucoup
plus efficace. C'est vrai que c'est une chose sur laquelle avant j'aurais
crié au scandale mais c'est quand même un confort. A partir du moment
où l'on utilise un archétype de ce type-là, on quand même la vie facilitée. Chris
Lamquet : Oui, ça c'est sûr, on fait des castings. C'est vrai
que quand j'ai créé Norge, plutôt que de me laisser aller à créer un personnage
qui serait vraiment original ou décalé de son temps pour le rendre justement
plus original, j'ai pris le parti-pris de l'archétype, l'archétype toujours
influencé par le cinéma américain. C'est Bruce Willis, le bonnet et la
veste de cuir flottante. Mais c'est vrai que ce sont des images que j'avais
envie de retranscrire et ça m'arrangeait parce que par son look le personnage
donne son comportement : cette attitude qu'il a avec ce bonnet ou ses
mains en poche est aussi parlante que de le faire parler lui-même. Donc
là, on est dans l'image d'Epinal. Et la bande dessinée, c'est ça en fait,
c'est très réducteur, la BD. Il faut dès la première case qu'on ait compris
le personnage. S'il faut commencer psychologiquement à développer comme
j'ai pu le faire dans un bouquin comme l'Amour hologramme chez Casterman
- mais là j'avais la place, j'avais 130 planches - , on en sort pas. Ici,
il faut en 46 planches typer des personnages de façon très simple, mais
efficace au niveau. Norge est typé justement pour qu'on sente le côté
cool, New Yorkais. Olga, la Russe, est typée comme une fille actuelle
avec son nombril à l'air. Ce sont des archétypes, je sais bien, mais c'est
efficace et, à la limite, le fait d'être débarrassé du souci de rendre
crédible le personnage par des tas d'artifices me permet de me défouler
au niveau scénario. Je suis libéré de l'aspect graphique du personnage
et je me défoule dans les dialogues. Donc c'est narrativement beaucoup
plus efficace. C'est vrai que c'est une chose sur laquelle avant j'aurais
crié au scandale mais c'est quand même un confort. A partir du moment
où l'on utilise un archétype de ce type-là, on quand même la vie facilitée.
Puisque Olivier Grenson est là, je vais
me tourner vers lui et lui poser la même question. Olivier, le look, le
casting, c'était important sur Niklos Koda ?
 Olivier
Grenson : Ce n'était pas important au départ parce que c'est
venu naturellement. J'ai commencé à dessiner une série de personnages
et je ne me suis pas vraiment posé de questions. Je ne sais pas comment
expliquer, j'ai fait toute une série de croquis dans un carnet donc il
y a eu une évolution. Au départ il n'avait pas sa petite barbiche et puis,
je voulais lui trouver un signe distinctif, quelque chose qui permette
au public de le reconnaître, même de loin, et l'identifier tout de suite,
un peu comme la houppe de Tintin. Et en même temps, ça correspond au personnage.
Je ne voulais pas qu'il ressemble au traditionnel « espion, costume, cravate
». Comme il a un petit quelque chose en plus au niveau de son rôle et
de sa psychologie, un côté artistique aussi, il a des capacités de magicien,
un petit don de manipulateur, je voulais que cela se ressente au niveau
du look. Olivier
Grenson : Ce n'était pas important au départ parce que c'est
venu naturellement. J'ai commencé à dessiner une série de personnages
et je ne me suis pas vraiment posé de questions. Je ne sais pas comment
expliquer, j'ai fait toute une série de croquis dans un carnet donc il
y a eu une évolution. Au départ il n'avait pas sa petite barbiche et puis,
je voulais lui trouver un signe distinctif, quelque chose qui permette
au public de le reconnaître, même de loin, et l'identifier tout de suite,
un peu comme la houppe de Tintin. Et en même temps, ça correspond au personnage.
Je ne voulais pas qu'il ressemble au traditionnel « espion, costume, cravate
». Comme il a un petit quelque chose en plus au niveau de son rôle et
de sa psychologie, un côté artistique aussi, il a des capacités de magicien,
un petit don de manipulateur, je voulais que cela se ressente au niveau
du look.
Pour reprendre la même question que celle
que j'ai posée à Chris, il n'y a pas de consigne éditoriale mais c'est
aussi une façon d'être vraiment dans la Troisième Vague, d'avoir des héros
qui fassent moderne.
Olivier Grenson : Non, pas vraiment.
Quand j'ai créé le personnage, je ne savais pas que la Troisième Vague
existait, c'est vraiment indépendant. On a créé Koda mais on ne savait
pas pour qui, on ne savait pas si ça allait être au Lombard ou ailleurs
et il se fait que quand on est arrivé au Lombard, Yves Sente nous a parlé
de son projet de la Troisième Vague et il nous a dit : « Ecoutez, c'est
vraiment génial, ça correspond tout à fait à une politique éditoriale
qu'on voudrait développer. » Donc c'est tout à fait par hasard. Il n'y
a pas d'à priori, ni de calcul.
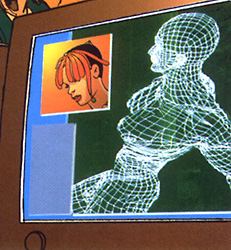
Merci à tous les deux.
Images Copyrights © Chris Lamquet - Editions du
Lombard 2000
Images Copyrights © Olivier Grenson - Editions du Lombard 2000
|
|
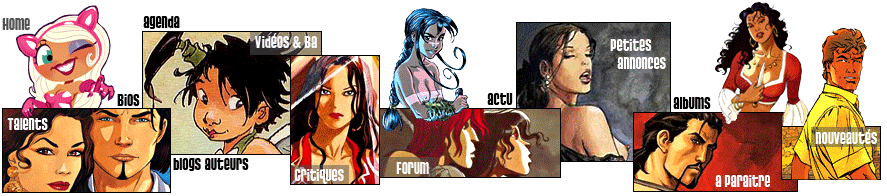
![]()