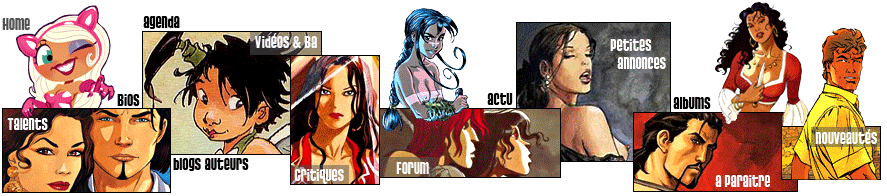
![]()
La structure d'une planche avec HermannLa séquence dans le cinéma structure le film. C'est quoi déjà ? Ce n'est pas évident. Comme tout art qui a le mérite de raconter des histoires, des étapes sont primordiales. Dans la bande dessinée, celles-ci s'imposent d'elles-mêmes aux graphistes. C'est une contrainte matérielle liée au support. Elle est tellement évidente qu'on ne la remarque pas : la planche. Oui la planche, elle est l'élément qui coordonne le récit. Les auteurs prennent en compte cet aspect dès leur début. De même que pour les confirmés, elle est primordiale. Hermann La ligne de force, voilà un terme technique qu'on ne rencontre pas souvent. Pourtant, cette subtilité graphique, on la rencontre à chaque page. Si elle n'est pas visible, elle est primordiale dans la lecture. Inconsciemment, elle permet aux yeux de sentir une unité, une structure, un équilibre. Elle guide le lecteur. Comme un immeuble, la planche a besoin d'un squelette, de charpentes solides pour tenir debout. La ligne de force joue cette fonction. Elle prend souvent sa source dans la première case. Dans l'architecture d'une planche, la première case est celle qui détermine toutes les autres. Une courbe dans celle-ci doit pouvoir poursuivre sa course dans les autres. Un personnage, un objet peut être le véhicule. Le support n'a pas d'importance. Le trait est l'élément qui s'impose. Il créait souvent une diagonale qu'on peut suivre sur deux, trois, voir quatre cases. Elle n'est pas unique. Sur une même page, elles sont nombreuses et elles se recoupent en un point stratégique. Un espace crucial dans le défilement du récit. Par une alchimie géographique, la tension se focalise dans cette espace. Le regard tombe dessus et inconsciemment il enregistre l'action. Pour Hermann "ces lignes font en sorte que toute la planche soit en réalité une et même case. C'est une case qui regroupe toutes les autres pour donner une cohérence à l'ensemble. Il ne faut, par contre, jamais que cet agencement soit une contrainte pour le récit. Si on cherche constamment la ligne de force, l'histoire perd de sa vigueur. Dans ce cas, ce n'est plus de la bande dessinée mais un ensemble graphique sans signification". "Le récit avant tout" "C'est comme les lignes de force, pour Hermann, cela devient automatique. On organise le récit en fonction de ces doubles pages. Il faut jouer sur cette subtilité pour préparer quelque chose. A la fin de la planche de droite, on peut mettre une sorte de conclusion pour ouvrir sur quelque chose de nouveau. Le lecteur doit souffler en tournant la page. Inversement, on met celui-ci en attente. On installe un suspense qui trouvera sa solution de l'autre côté. Là, le lecteur inspire et garde sa respiration. Cet effet est primordial pour marquer un temps de pause. C'est une mise en scène d'une action extérieure à l'auteur. Par cette combinaison, il donne forme au geste du lecteur". L'auteur de bande dessinée accorde beaucoup d'importance à la planche, mais cela n'a pas toujours été le cas. Il existe une période où le souci de la planche en tant qu'ensemble organisé n'existait guère. Elle correspond à une époque où tout se trouvait conçu en fonction des nécessités de la publication dans les quotidiens. Jean-Michel Charlier l'expliquait judicieusement dans l'ouvrage de Benoît Peeters : "Au début de ma carrière, on vous imposait un découpage tel que la planche puisse se diviser et s'agencer de différentes façons. C'est-à-dire que la page, qui était idéalement composée de quatre bandes de trois dessins, devait pouvoir se recomposer en strips quotidiens, ou même en colonnes. Cela a notamment été le cas pour Buck Danny, dans Spirou. Cet agencement était censé permettre des reventes multiples d'une histoire". La définition de "bande" dans le Larousse est simple : "morceau d'étoffe, de papier, etc., long et étroit". Comme on l'a vu, le 9ème Art n'est pas une succession de dessins sur un morceau de papier long et étroit, mais un véritable travail de recherche pour unifier un ensemble bien défini. Mais chaque auteur a sa propre approche. Pour Bézian, on découvre certaines précisions supplémentaires.Rien n'est laissé au hasard. Votre ouvrage « Chien rouge, chien noir » a quelques spécificités. Les cases blanches ne sont pas un outil narratif très répandu dans la BD. Quelle signification précise ont-elles dans le récit ? "Les différences notables entre la bande dessinée et le cinéma sont, me semble-t-il, plus nombreuses qu'il paraît. Le fait de disposer, sur le papier, d'une juxtaposition de séquences dont l'oeil embrasse un nombre variable sur une page ou deux en vis-à-vis, offre déjà de multiples ressources graphiques et narratives. Des combinaisons illimitées prenant en charge ces pages où le regard est censé suivre une route codée, la chose imprimée, une succession d'éléments montrés, d'autres cachés. Tous ces éléments, pour créer du sens, ont pour but d'atteindre un pouvoir de suggestion si particulier. Et cela bien sûr, en évitant de tomber dans le piège trop fréquent de "faire du cinéma sur papier", puisqu'on ne dispose pas du "temps réel". Toutes ces considérations, mêlées à l'admiration que je porte aux travaux de certains illustres prédécesseurs en littérature, en musique, au cinéma et en bande dessinée, m'ont porté à essayer de faire avec "Chien rouge - Chien noir" quelque chose d"infaisable autrement" qu'en bande dessinée. Quant au SENS desdits "trous", il faut peut-être que le lecteur se souvienne du fait qu'il n'est PAS au cinéma. Il a un objet entre les mains qu'on nomme livre, avec des pages qu'il peut tourner à sa guise, sauter. Il peut revenir en arrière dans sa lecture.. Bref, un livre est un objet qu'on peut manipuler dans tous les sens.. Dans le cas de "Chien rouge-Chien noir", il est facile de noter, par exemple, que le cadre des cases vides est ROUGE. Je ne tiens pas à mâcher le boulot. L'auteur a un travail à assumer et à maîtriser autant que possible. Mais je maintiens que le lecteur, le spectateur, l'auditeur ont aussi un travail à faire, à mon sens, ne serait-ce que pour lui éviter d'asséner en deux secondes à un travail d'une ou plusieurs années "C'est génial !" ou "C'est nul !" "Chien rouge-Chien noir" fut pour moi une tentative de prise en charge de tous les éléments dont dispose le code "bande dessinée" afin de créer du sens (= raconter une histoire). Il me paraît impossible d'en faire autre chose qu'une bande dessinée, dans la pleine acceptation de son artificialité. Dans la BD "le regard suit une route codée". Pour cela, vous avez tenté d'organiser des "rythmes" dans la page. Justement en dehors des éléments visuels (le noir, le bleu, le rouge, le blanc et les trous), en ce qui concerne l'architecture de la planche, vous utilisez la "ligne de force". Dans le cas des cases blanches, celle-ci n'est plus présente. Alors comment faites-vous pour y remédier, pour donner un équilibre, pour que la planche tienne "debout" en quelque sorte ? Pour ce qui est des lignes de force narratives, c'est par définition plus sournois. C'est une combinaison plus ou moins compliquée des divers foyers d'intérêts déterminés par l'histoire. Ce sont des choix aussi judicieux que possibles avec, par exemple, des interruptions de discours, des irruptions de personnages, des regards chaotiques, zigzagants ou tranquillement normaux qu'on veut suggérer à la lecture... Il est bien évident que tous ces trucs ne sont pas infaillibles. L'auteur déploie des stratagèmes plus ou moins sophistiqués pour hypnotiser le lecteur jusqu'à lui faire LIRE et DECRYPTER tout un album, dans l'ordre, de la première à la dernière page et d'une seule traite. Le lecteur, quant à lui, garde toute liberté pour lire l'album en diagonale, sauter dix pages, revenir en arrière, ou tout bonnement laisser tomber au bout de trois pages. A moins qu'il se borne seulement à le feuilleter en quelques secondes. C'est un rapport de force mystérieux ou les deux combattants n'agissent pas en même temps et ne se voient pas. Je peux toutefois préciser qu'en ce qui me concerne - et je ne suis pas le seul que ça concerne - les lignes de force qui traversent mes planches depuis environ vingt ans, ne le font pas "sans que je m'en rende compte" ! Dans "L'Etrange Nuit de Monsieur Korb", mon deuxième album, des formes plus ou moins chaotiques apparaissaient dans mes planches (j'avais constamment travaillé mes pages deux par deux...), profitant des effets bichromiques noirs et rouges, lesquels devenaient au fur et à mesure des axes de plus en plus ordonnés, puis deux arcs de cercles barraient la double-page, devenaient un X, puis un rond, suivaient quelques pages dont les scènes à l'ambiance particulière tenaient lieu de pivot central ; on voyait réapparaître l'X, les deux arcs de cercles, et tout le processus s'inversait jusqu'à la fin de l'album. Il se terminait comme il avait commencé. J'avais suffisamment transpiré sur la conception de ces agencements pour pouvoir affirmer qu'elle n'était pas inconsciente ! Par Brice Boune
|
(http://www.BDParadisio.com) - © 2000, B. On The Net