 |
Québec, le 1er juin 1997. À compter du 11 juin prochain, le Musée du Québec propose au public une
exposition consacrée à la bande dessinée québécoise. L’exposition couvre le siècle et rassemble créateurs et
personnages dans une scénographie bédéiste. La réalisation du projet a été confiée à Mira Falardeau, elle-même
créatrice de dessins d’humour et de BD, enseignante et spécialiste de la bande dessinée, auteure de La Bande
dessinée au Québec, publié chez Boréal en 1994. Les aventures de la bande dessinée québécoise se poursuit
jusqu’au 21 septembre 1997, à la salle 4 du Musée.
C’est le centenaire de la création de la bande dessinée qui
sert de prétexte à la présentation de ce bilan sur l’apport des
créateurs québécois à cette forme d’art.
Par le biais de ses personnages types, ses héros et héroïnes,
le visiteur est convié à découvrir la bande dessinée
québécoise depuis sa création au début du siècle dans les
grands journaux, jusqu’aux plus récentes bandes dessinées
d’avant-garde.
Des planches originales, des journaux anciens et des revues,
des albums et des agrandissements permettront d’apprécier
l’art des créateurs québécois en BD.
Des sites interactifs de même que des espaces de lecture
compléteront la visite de l’exposition. | Autour de l’exposition
Ateliers Dimanche Famille
Mon héros de bande dessinée
Création, en trois dimensions, d’un personnage qui prendra
ensuite vie à l’intérieur d’une bande dessinée. Le dimanche
15 juin à 13 h et 15 h. Accès gratuit avec le billet d’entrée au
Musée. Laissez-passer requis : 418.643.3377. Pour les
enfants de 4 ans et plus, accompagnés d’un adulte. Il est
préférable de visiter l’exposition avant de participer à
l’atelier.
Impro Bd
Comme l’impro-théâtre, l’impro-BD met en scène deux
équipes qui s’affrontent sur des thèmes imposés (policier,
humour, science-fiction, etc.) avec certaines contraintes
(impro à relais, nombres de cases limitées, etc.). Les joueurs
doivent dessiner dans un laps de temps annoncé par
l’arbitre et, bien sûr, le public vote pour la meilleure impro.
Avec les impro-bédéistes Louis Rémillard, Serge Gaboury,
Jules Prud’homme, Marc Auger. Le vendredi 13 juin à 20 h.
Gratuit. |
Pour tout savoir sur la bande dessinée québécoise, une visite au Musée s’impose, du 11 juin au 21 septembre
prochain. Le Musée est ouvert tous les jours, de 10 h à 17 h 45, les mercredis jusqu’à 21 h 45. Entrée : 5,75 $.
Source et renseignements : Lise Boyer, responsable des relations publiques,
418.646.4743
Suzanne LeBlanc, direction des Communications
Zone 1 : Les débuts dans la grande presse
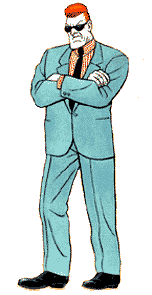
Réal Godbout, Red Ketchup, 1995 | Ce sont les nouvelles techniques d’impression
apparues à la fin du XIXe siècle, la linotypie et la
photogravure, qui permettent l’éclosion de la bande
dessinée. Héritier de la caricature et des histoires en
images, ce nouveau langage humoristique voit le jour
aux États-Unis en 1897. Au Québec, c’est en 1904,
dans le journal La Patrie, que paraissent les premières
bandes dessinées. Le journal engage son premier
bédéiste cette année-là, Albéric Bourgeois. Celui-ci
devient rapidement le chef de file et l’animateur des
dessinateurs qui travaillent dans les deux quotidiens
montréalais, La Patrie et La Presse. L’esprit de
collaboration entre ces artistes se développe au point
qu’ils échangent entre eux héros et histoires. Ces
débuts prometteurs de la bande dessinée québécoise
sont cependant freinés par le dumping des «comics »
américains. Ainsi, entre 1909 et le début des années
1930, la BD québécoise disparaît presque des
quotidiens. Les premières bandes dessinées réalisées
au Québec s’adressent à un public adulte. Elles
s’inspirent notamment du comique de situation qui
prévaut à l’époque dans le théâtre populaire. Certains
sujets sont puisés dans les difficultés d’adaptation
rencontrées par des « ruraux » ou des émigrés arrivant
en ville et confrontés à un nouveau style de vie. Ainsi,
par les liens qu’elle établit entre le texte et l’image, on
peut dire que la BD facilite l’intégration de ces
nouveaux arrivants. Les personnages aux positions
stéréotypées se déplacent en sautillant et racontent
dans des dialogues savoureux, mélange de joual et de
figures de style plus raffinées, les problèmes vécus par
bon nombre de lecteurs de ces journaux. |
Zone 2 : La grande presse et les hebdomadaires 1920-1940
Entre les années 1920 et 1930, les quotidiens québécois présentent à chaque parution une page de bandes
dessinées américaines traduites. C’est au contact des «comics » américains que les auteurs québécois des années
1930-1940 apprennent les trucs de la BD moderne. À partir des années 1930, le nouvel essor de la bande
dessinée québécoise est lié aux innovations mises de l’avant par la presse écrite. L’ajout, à chaque fin de semaine,
d’un supplément illustré au quotidien et l’apparition de journaux hebdomadaires permettront à plusieurs
dessinateurs de publier régulièrement. Albert Chartier se démarque à cette époque avec son héros bègue et
maladroit, Onésime. Celui-ci deviendra le personnage le plus persistant de la bande dessinée québécoise. La
diversité est la caractéristique de cette longue période. Les dessinateurs, souvent issus du monde des
caricaturistes, pratiquent plusieurs activités artistiques en parallèle : dessinateurs de mode, d’humour populaire et
d’histoires religieuses, illustrateurs pour la presse. La production s’adresse avant tout à la famille. Les thèmes qui
les inspirent sont de nature religieuse ou puisés aux situations vécues quotidiennement par la classe moyenne.
Zone 3 : La presse engagée 1968-1980
Au début des années 1960, la bande dessinée québécoise prend un nouveau tournant. Elle devient le canal
d’expression privilégié par la jeunesse contestataire de la Révolution tranquille pour faire valoir ses idées. Elle est
présente partout : dans les publications étudiantes, dans les organes de diffusion des partis politiques de gauche ou
dans les revues underground qui commencent à voir le jour. La bande dessinée québécoise connaît alors une
vigueur nouvelle et son discours devient plus éclaté. Les sujets abordés par les bédéistes vont de l’explication du
monde au délire hallucinatoire, en passant par l’appel à la révolution. Le style des bandes dessinées suit la diversité
des discours et devient un sujet d’expérimentation. Il oscille entre deux pôles : d’un côté la BD intellectuelle qui
accentue les textes au détriment du dessin ; de l’autre la BD psychédélique dans laquelle le dessin et le texte se
confondent et débordent la case. Les thèmes, le style et le langage, plus poétique et théâtral, destinent cette
production à un public adulte averti.
Zone 4 : Les revues Croc et Safarir
De 1979 à 1995, la revue humoristique Croc est l’un des grands diffuseurs de la bande dessinée au Québec 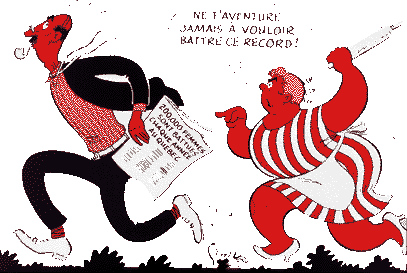 puisqu’elle y occupe entre la moitié et le
tiers du magazine. Plus d’une centaine de
créateurs en BD ont travaillé à un moment
ou un autre pour ce magazine montréalais
et parmi ceux qui se démarquent, il y a
entre autres Gaboury, Godbout, Mérola,
Prud’homme. Tous les types de langage
s’y retrouvent et côtoient la bande dessinée
: la satire, la caricature, le dessin d’humour
et les montages photographiques avec
bulles. Caractérisé par un humour
intellectuel de gauche, très critique sur la
politique et le système en place, ce
magazine s’adressait à un public
majoritairement adulte. En 1983-1984,
Croc publie Titanic, une revue
entièrement consacrée à la bande dessinée. En 1987, l’arrivée d’une seconde revue d’humour, Safarir, modifie
l’échiquier de la BD québécoise. Un humour populaire, destiné aux adolescents et aux jeunes adultes, caractérise
ce magazine de Québec. Les satires des émissions de télévision, des films et des vedettes du showbiz composent
le menu principal du magazine. Les bédéistes vedettes sont notamment Goulet, Morin, et Daigle. Dans les années
1990, les tendances deviennent moins claires : Croc devient populiste tandis que Safarir tente de se rapprocher
des lecteurs plus âgés en levant certains interdits de la ligne éditoriale concernant la sexualité et les grossièretés.
Depuis que Croc a cessé ses activités en 1995, le profil de la BD professionnelle au Québec est conditionné par la
seule revue d’humour Safarir. Des auteurs au style personnel, tels Côté et Vallée, y côtoient désormais Gaboury
et Eid, transfuges du défunt Croc.
puisqu’elle y occupe entre la moitié et le
tiers du magazine. Plus d’une centaine de
créateurs en BD ont travaillé à un moment
ou un autre pour ce magazine montréalais
et parmi ceux qui se démarquent, il y a
entre autres Gaboury, Godbout, Mérola,
Prud’homme. Tous les types de langage
s’y retrouvent et côtoient la bande dessinée
: la satire, la caricature, le dessin d’humour
et les montages photographiques avec
bulles. Caractérisé par un humour
intellectuel de gauche, très critique sur la
politique et le système en place, ce
magazine s’adressait à un public
majoritairement adulte. En 1983-1984,
Croc publie Titanic, une revue
entièrement consacrée à la bande dessinée. En 1987, l’arrivée d’une seconde revue d’humour, Safarir, modifie
l’échiquier de la BD québécoise. Un humour populaire, destiné aux adolescents et aux jeunes adultes, caractérise
ce magazine de Québec. Les satires des émissions de télévision, des films et des vedettes du showbiz composent
le menu principal du magazine. Les bédéistes vedettes sont notamment Goulet, Morin, et Daigle. Dans les années
1990, les tendances deviennent moins claires : Croc devient populiste tandis que Safarir tente de se rapprocher
des lecteurs plus âgés en levant certains interdits de la ligne éditoriale concernant la sexualité et les grossièretés.
Depuis que Croc a cessé ses activités en 1995, le profil de la BD professionnelle au Québec est conditionné par la
seule revue d’humour Safarir. Des auteurs au style personnel, tels Côté et Vallée, y côtoient désormais Gaboury
et Eid, transfuges du défunt Croc.
Zone 5 : Bande dessinée jeunesse
Longtemps dominée par les sujets religieux et historiques, la bande dessinée québécoise destinée à la jeunesse
connaît un regain de vigueur dans les années 1970. En effet, l’arrivée de plusieurs revues destinées aux enfants
permet de diversifier le répertoire des sujets. L’interdiction de publicité pour la jeunesse explique en partie le peu
de longévité de ces magazines et rares sont çeux qui ont réussi à survivre. Vidéo-Presse en 1971, puis Je me
petit débrouille en 1982 - qui devient en 1992 Les Débrouillards - ont marqué les publications pour enfants.
Pendant ses 25 ans d’existence, Vidéo-Presse a publié près de 2 000 bandes dessinées différentes. Dans la
bande dessinée jeunesse, l’humour et l’aventure côtoient la science et la science-fiction. L’effet poétique et
l’imagination sont à l’honneur et les mondes imaginaires ou parallèles ont la vedette. L’action est transposée dans
un monde d’animaux ou d’enfants sans adultes. Quelques BD d’aventures se déroulent dans des univers déjà
familiers mais devenus mythiques à force de réutilisation, comme la jungle et la mégalopole. Quelque soit le thème,
il y a presque toujours un héros dans le scénario. Mais c’est davantage par les éléments visuels que par le texte
que les bédéistes s’adressent à la jeunesse. Images attrayantes, couleurs chatoyantes et décors somptueux
constituent l’univers des bandes dessinées pour la jeunesse dont certaines sont marquées par des influences de la
BD franco-belge.
Zone 6 : Les fanzines
Étymologiquement, le terme fanzine désigne un magazine pour fanatique. Publié à compte d’auteur et même
quelquefois photocopié, le fanzine traite des sujets les plus divers. Ces revues de bandes dessinées, généralement
sans copyright, sans périodicité et sans ligne éditoriale, ne connaissent pas de frontières puisqu’elles circulent dans
les circuits parallèles. École pour les débutants, lieu de ressourcement et laboratoire pour les artistes
professionnels, on peut difficilement imaginer la BD québécoise sans le fanzine. Il permet à ces créateurs, qui vont
d’un fanzine à l’autre, de produire de la bande dessinée en dehors des conventions habituelles. Au Québec, le
fanzinat se développe avec l’arrivée de la BD underground dans les années 1960-1970 pour prendre de l’ampleur
dans les années 1980. Au cours des dix dernières années, de nombreux fanzines ont eu des durées de vie plus ou
moins longues : Tchiize (1975-1985), Bambou (1986-1991), Iceberg (depuis 1985), Mac Tin Tac (depuis
1990) et Zeppelin (1992-1993). Le fanzine montréalais Drawn & Quarterly apparaît comme l’un des plus
vigoureux. Créé en 1991, il réunit des auteurs américains, français, allemands et canadiens, tant francophones
qu’anglophones. L’art du fanzine est provocateur. Héritier du dadaïsme et du surréalisme, il fait à la fois l’éloge et
la critique de la violence, se contredit pour mieux se libérer des contraintes et ne craint pas la critique. Bandes
dessinées scatologiques, érotiques, philosophiques et poétiques s’y côtoient. Les styles sont incisifs et tranchants.
Zone 7 : Les «comics-books » et les superhéros
L’histoire des superhéros est liée à celle des «comics-books ». C’est dans les années 1930 que les Américains
inventent ces revues bon marché, imprimées sur du papier journal avec une couverture sur papier glacé, qui
permettent de diffuser sur les marchés mondiaux les héros américains. La Seconde Guerre mondiale oblige les
Américains à interrompre leurs livraisons, mais les Canadiens, fervents lecteurs de « comic-books », créent à ce
moment-là leurs propres superhéros : Nelvana (1941), Johnny Canuck (1942), Canada Jack (1943). Dans la
première vague, le superhéros est modelé sur la mythologie : mi-dieu, mi-homme, il a des pouvoirs divins, se
déplace à la vitesse de l’éclair et possède un physique à la mesure de sa force herculéenne. Son combat, celui du
bien contre le mal, prend toutes les formes imaginables. La seconde vague se développe au Québec dans les
années 1970 et 1980. Les superhéros se transforment pour devenir des objets de dérision tels Capitaine
Canada (1972) et Capitaine Kébec (1973). D’autres, comme Northguard (1984) et Fleur de Lys (1989),
apparaissent comme les portes étendards des causes nationaliste, canadienne ou québécoise.
| |
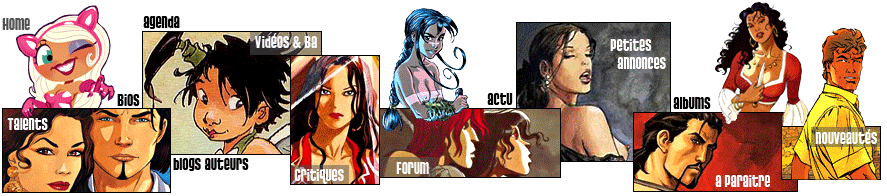
![]()