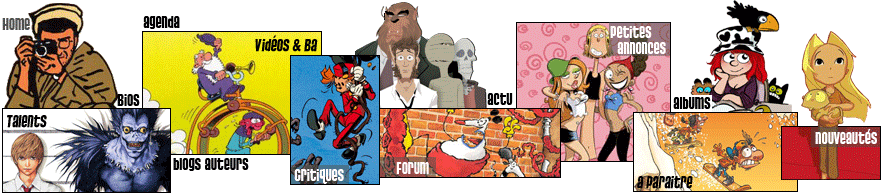Patatras. Tant d’années à utiliser un mode impersonnel, nous voilà revenu au bon vieux temps du « je ». Ce « je » honni, celui qui personnalise les chroniques, les ramène au rang de « simple » avis personnel. Pourquoi ? Parce que je n’aime pas « Blast ». Ou plutôt, je n’ai pas aimé le premier « Blast ». Soyons honnêtes jusqu’au bout : j’ai trouvé « Grasse carcasse » déroutant et dérangeant. Parce que Larcenet impose avec Mancini un personnage pour lequel il est difficile d’éprouver de l’empathie ; parce que les thèmes développés flirtent avec l’outrance ; sans doute aussi parce que cette évocation des ravages de la différence touche trop profondément à l’intime de ceux qui doivent également, pour toute autre raison, se confronter au regard des autres ; parce qu’au-delà de l’admiration que je peux porter à son œuvre, je me méfie du bonhomme, capable d’alterner portraits sensibles et caricature (police et journalistes s’en sortent généralement assez mal), coups de main et coups de gueule, leçons de vie et diatribes péremptoires.
Impossible pourtant, à la lecture de ce premier livre, qui semble faire la jonction entre le Larcenet sensible et finalement solaire du « Combat ordinaire » et celui, sombre et torturé, de son « Ex Abrupto », de faire abstraction du talent de Manu Larcenet, de son évolution graphique, de sa maîtrise de la narration. Répulsion et admiration. L’historien de l’art - ma formation initiale - doit pouvoir dissocier l’affect et la réflexion, travailler sur la démarche de l’auteur. Un autre chroniqueur a pris le relais au clavier. C’était finalement plus simple. On appelle ça botter en touche, on a tous nos petites lâchetés.
Avril 2011. « L’apocalypse selon Saint Jacky » est là, sur ma table, plus question de se défiler. La méfiance est toujours là. Le terrain sur lequel s’avance Larcenet est cependant plus tangible pour l’ancien fait-diversier qu’est votre serviteur. L’errance de Polza est plus familière, de celles qui alimentent régulièrement la chronique judiciaire. Pour autant, la gêne subsiste. Car Larcenet s’engage en terrain miné. La quête autodestructrice de Polza Mancini, sa recherche effrénée de moments d’oubli de soi, son addiction au « blast », qu’il obtient par le biais de médicaments, de l’alcool ou de la drogue, restent suspectes à ceux qui prétendent comme moi conserver « l’illusion du contrôle », tout comme elles peuvent faire sourire ceux qui ont fait le tour de la question, ou tout du moins celui de la littérature estampillée Beat Generation.
« Blast » captive malgré tout. Il y a le passé de Mancini, révélé à petite touches, qui vient conforter la psychologie d’un personnage hors gabarit, « construit autour de la douleur. » Il y a ce regard particulier porté sur l’obésité, stigmatisée comme une tare par une société qui ne reconnaît plus que la norme mannequin. Il y a cette violence crue, réalité sans fard du monde de la nuit, qui s’invite dans l’utopie perturbée de Mancini. Il y a enfin le graphisme de Larcenet, son trait acéré, son sens de la lumière, ces moments de noirceur intense, ses fulgurances... Et ce rythme particulier, qu’il puise dans une lecture intensive de l’œuvre de Tanigushi, mais qui semble aussi se nourrir de Miyasaki. Et on joue le jeu. On se laisse prendre aux explications hallucinantes et hallucinées de ce bonhomme tordu par la vie, de cet être improbable dont l’humanité devient pourtant plus évidente à chaque page. Un homme accusé d’un crime dont on ne sait par ailleurs toujours rien – ou si peu – au bout des 400 premières planches.
Faut-il dès lors brûler ou adorer « Blast » ? La seconde option s’impose. Pour toute les raisons qui font que je l’admire, pour toutes les raisons qui font qu’il me dérange. L’outrance est toujours là, certains parti pris aussi. Mais il est du rôle de l’artiste de bouger les lignes, de bousculer ses lecteurs, de les amener sur des terrains plus glissants, de les mettre en danger, parfois malgré eux. Il ne faut pas lire « L’apocalypse selon Saint Jacky » par suivisme ou par snobisme, mais se l'approprier avec la volonté de comprendre un auteur qui met ses tripes sur la table. Un auteur qui signe avec « Blast » une œuvre plus courageuse qu’il n’y paraît. Il fallait bien la notoriété – et la singularité – d’un Manu Larcenet pour imposer un tel projet chez un éditeur grand public.